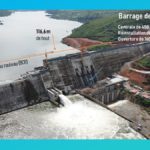Droits de l’homme
Le 28 septembre 2009, les manifestants de l’opposition se rassemblent et marchent depuis la banlieue de Conakry pour dire « non » à une candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, militaire arrivé au pouvoir par un coup d’État dix mois plus tôt. La date est symbolique, le lieu de rassemblement aussi : les militants des Forces vives se regroupent au stade portant le nom du jour où la Guinée a voté pour son indépendance, le stade du 28 septembre. Ils sont des milliers, réunis dans une ambiance de fête. Puis tout bascule : des hommes en uniforme, mais aussi en civil, entrent dans le stade, ouvrent le feu sur la foule, violent de nombreuses femmes.
Les assaillants s’affranchissent de toute morale, souillent les âmes, blessent les corps, enlèvent les vies. Et s’il est difficile de comprendre le moteur d’un tel déchaînement de violence, ce qui s’est passé dans le stade semble ne pas être complètement étranger aux tendances décrites dans ce livre : une violence d’État se sentant autorisée à broyer les vies humaines qui lui posaient problème, une violence utilisée par des corps habillés pour faire taire toute velléité de contestation. Il y a eu des précédents, notamment la répression violente des manifestations de 2007 sous la présidence de Lansana Conté. L’impunité règne.
Pour tenter de mieux saisir ce qui s’est passé le 28 septembre 2009, cette sixième partie propose une enquête inédite sur le massacre et la façon dont les violences se sont prolongées les jours suivants. On y trouvera aussi le témoignage d’une jeune recrue du camp militaire de Kaleah qui a été chargée d’évacuer des blessés et de transporter des corps. Cette ultime partie du livre donne également à entendre le besoin de justice des victimes de violences politiques, à l’image d’Asmaou Diallo, la présidente de l’AVIPA, l’Association des victimes, parents et ami-e-s du 28 septembre.
28 septembre 2009, la toute-puissance des militaires et un déchaînement de violence
« … Les manifestants étaient des biens personnels pour eux. Les militaires nous faisaient ce qu’ils voulaient, sans arrière-pensée. »
Lundi 28 septembre 2009, dès le petit matin, des milliers de personnes se dirigent vers le stade de Conakry à l’appel de l’opposition. Elles réclament des élections et surtout exigent que Moussa Dadis Camara ne soit pas candidat.
Ce capitaine de l’armée est président depuis neuf mois. Moussa Dadis Camara a pris le pouvoir au lendemain de la mort de Lansana Conté, le 23 décembre 2008. Il est jeune, très populaire et beaucoup s’enthousiasment pour ses promesses de changement. Le régime militaire du CNDD (Conseil national pour la démocratie et le développement) a beau avoir dissout le gouvernement et suspendu la Constitution, il incarne un espoir pour de très nombreux Guinéens. Les premiers mois seulement. En septembre 2009, l’enthousiasme commence à retomber.
De l’aveu d’un ancien membre du CNDD, Moussa Dadis Camara a pris goût au pouvoir et a commis des erreurs politiques, en parlant de son avenir à la tête de l’État. Contrairement à ce qu’il avait promis au moment du coup d’État, il n’exclut plus d’être candidat à l’élection présidentielle, prévue quelques mois plus tard.
L’opposition et la société civile réunies au sein du forum des Forces vives annoncent alors une grande manifestation dans la capitale. « Le rassemblement du 28 septembre avait pour objectif d’organiser un référendum d’une autre manière, explique Bah Oury, premier vice-président de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée ) et responsable de l’organisation de la manifestation. Pas par le vote, mais par le nombre de citoyens guinéens qui allaient sortir ce jour-là, pour montrer leur défiance vis-à-vis de la continuation d’un régime militaire. »
Empêcher la manifestation
La junte décide d’interdire le rassemblement, avançant différents motifs dans les jours qui précèdent les événements. Les autorités ont d’abord expliqué que le stade était fermé en prévision d’un match de football prévu en octobre, pour ne pas abîmer le terrain. Elles ont ensuite interdit toutes les manifestations jusqu’à la fête nationale du 2 octobre. Enfin elles ont expliqué que le 28 septembre étant une commémoration nationale, la journée serait fériée. Le président a même essayé de convaincre l’opposition de renoncer, par téléphone, en pleine nuit, la veille du rassemblement.
Sidya Touré, président du parti d’opposition Union des forces républicaines et membre du forum des Forces vives, se souvient : « Le téléphone a sonné à une heure du matin. J’ai vu que c’était Tibou Kamara qui m’appelait, il m’a dit que le président voulait me parler. Dadis a commencé à m’expliquer qu’on ne devait pas organiser cette manifestation, qu’il ne souhaitait pas que le meeting ait lieu.
Je lui ai répondu calmement qu’il était une heure du matin et que la mobilisation commençait à sept heures, que je n’avais aucune possibilité de parler à qui que ce soit. Et que ce n’était pas la solution.
Le conseiller qu’il avait à côté de lui a commencé à dire : «Il faut insister sur l’autorité de l’État.» Je l’ai entendu répéter ça : «L’autorité de l’État, l’autorité de l’État !» J’ai répondu : «C’est très bien l’autorité de l’État mais tu m’as appelé parce que tu me dis que nous avons de bonnes relations toi et moi. Est-ce que je peux te donner un conseil ?» Je ne sais pas s’il a dit oui, toujours est-il que j’ai donné mon conseil. Je lui ai dit : « Tu viens de passer plusieurs jours en campagne dans la région du Fouta. L’opposition, qui n’a pas disparu parce que tu es arrivé, a décidé d’aller au stade pour faire une déclaration. À ta place, j’attendrais que cette déclaration soit faite, et peut-être que mercredi, tu pourrais convoquer un Conseil national pour que tout le monde se retrouve et qu’on commence à discuter de transition et tout ça. «Ah…», c’est reparti : «Je n’accepterai pas ! L’autorité de l’État !»
Le téléphone s’est coupé. Il a sonné de nouveau quelques minutes plus tard. Dadis s’est lancé dans une logorrhée de discours, je me souviens seulement qu’à la fin, il a dit qu’il ne permettrait jamais cela.
Je n’imaginais pas ce qui allait arriver. Je me suis dit : « mais, comment il ne peut pas permettre la manifestation ? De toute façon, on sera dans la rue, qu’est-ce qu’il va faire ? »
Je n’imaginais pas ce qui allait arriver. Je me suis dit : mais, comment il ne peut pas permettre la manifestation ? De toute façon, on sera dans la rue, qu’est-ce qu’il va faire ? »
Dès le début de la matinée, la ville était quadrillée par les forces de l’ordre.
Une source au sein de la gendarmerie explique qu’il avait été décidé de ne mobiliser que des forces de maintien de l’ordre. La décision avait été prise la veille au cours d’une réunion entre le chef des armées, les chefs d’état-major, ainsi que les responsables de la police et de la gendarmerie. Rassemblés au camp Samory, ils ont décidé que les militaires ne seraient pas déployés. Selon notre source à la gendarmerie, les hommes devaient être mobilisés sans armes létales pour essayer d’empêcher le rassemblement.
Le rassemblement malgré tout
Lundi matin, gendarmes et policiers sont effectivement présents aux principaux carrefours de Conakry et dans les quartiers réputés favorables à l’opposition. Premières échauffourées. Les forces de l’ordre lancent des grenades lacrymogènes, tirent en l’air puis ouvrent le feu sur la foule au rond-point Bellevue. Deux manifestants sont tués.
Un ancien policier raconte qu’au même endroit, des jeunes ont attaqué le commissariat et emporté des armes. L’un des organisateurs de la manifestation assure qu’il s’agissait de vieux fusils non-chargés et laissés sur place, qu’aucune arme n’est entrée dans le stade.
Le rapport de la Commission d’enquête des Nations unies confirme que des armes ont bien été emportées par des personnes en civil mais précise, en s’appuyant sur des images et un témoignage, que ces personnes « n’ont pas pris la direction du stade et que certains des voleurs ont été vus marchant à contre-courant des manifestants. Il pourrait dès lors s’agir de délinquants », conclut le rapport.
Les sympathisants de l’opposition reprennent leur marche vers le stade du 28 septembre et commencent à se rassembler sur l’esplanade, devant l’entrée principale.
Une source provenant de la gendarmerie affirme qu’aucun gendarme n’a été envoyé sur les lieux « puisqu’il était interdit d’y aller » et qu’il avait été décidé de déployer les équipes dans le reste de la ville. Plusieurs témoins assurent cependant avoir vu des gendarmes en arrivant au stade.
Ils expliquent également avoir vu une autre unité des forces de l’ordre. En Guinée, certains gendarmes et policiers sont détachés au sein d’une unité spéciale mise en place par le CNDD, la brigade de lutte contre la drogue et le grand banditisme. Le groupe porte une tenue similaire à celle des membres de la gendarmerie nationale, pantalons treillis et T-shirts noirs. À la tête de ces services spéciaux, le colonel Moussa Tiegboro Camara.
Les hommes de la brigade sont placés sous son autorité directe, explique une source à la gendarmerie. Ce groupe aurait donc pu être envoyé au stade sans que le haut-commandement de gendarmerie en soit informé.
C’est à ce moment-là qu’il a reçu un appel l’informant qu’on tirait à l’intérieur du stade.
Le colonel Tiegboro s’est d’ailleurs rendu sur les lieux le matin du 28 septembre. Selon l’un de ses proches, « sur la route entre le camp et son domicile, vers huit heures, le colonel a parlé à des manifestants en leur disant que le rassemblement était interdit et qu’ils devaient rentrer chez eux. Après avoir mangé chez lui, le colonel Tiegboro a pris la direction de son bureau mais s’est arrêté pour parler aux responsables de l’opposition devant l’université, à quelques centaines de mètres de l’entrée principale du stade. Il a répété le message et l’opposition a accepté de sursoir au rassemblement. En échange, les leaders avaient demandé la libération de tous ceux qui avaient été arrêtés plus tôt le matin. Le colonel Tiegboro s’est rendu à la CMIS (Compagnie mobile d’intervention spéciale) où il s’est aperçu que personne n’avait été interpellé. C’est à ce moment-là qu’il a reçu un appel l’informant qu’on tirait à l’intérieur du stade. »
La version des manifestants est tout autre : ils expliquent que le colonel Tiegboro était menaçant lorsqu’ils l’ont croisé. Les responsables politiques, quant à eux, affirment qu’il n’a jamais été question de renoncer au rassemblement.
Ce matin-là, ils s’étaient donné rendez-vous au domicile de Jean-Marie Doré, porte-parole des Forces vives et leader de l’UPG (Union pour le progrès de la Guinée) : « La raison de ce choix, c’est simple : c’est parce que son domicile était le plus proche du stade, se souvient Mouctar Diallo, leader des Nouvelles forces démocratiques et membre des Forces vives, mais dès le matin, on a senti qu’il y avait anguille sous roche. » Jean-Marie Doré refuse de se rendre au stade. « Je ne sais pas pourquoi, explique Bah Oury, premier vice-président du parti d’opposition UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée) et responsable de l’organisation de la manifestation, il a juste fait savoir qu’il ne voulait pas. »
En fait, selon des proches de Jean-Marie Doré, décédé en 2016, la décision était prise depuis plusieurs semaines déjà. Mamounan Kpokomou, membre du bureau politique de l’UPG (Union pour le progrès de la Guinée) depuis 1993, explique : « Nous sommes de la même région que le chef de la junte. Notre parti est national, mais la base c’est bien la Guinée forestière, où est né Moussa Dadis Camara.
Nous défendions un idéal, nous étions diamétralement opposés à la candidature d’un militaire, mais nous avions choisi de ne pas prendre part à la marche du 28 septembre. Nos parents analphabètes, qui constituent le gros de notre électorat, ne nous auraient pas compris. Nous avions donc pris la résolution de ne pas y aller de peur de perdre cet électorat, qui n’aurait pas accepté de nous voir nous joindre aux autres partis politiques pour lutter contre un fils du terroir. »
C’est pourtant Jean-Marie Doré qui a été choisi pour une dernière médiation, le matin du 28 septembre. Il a été sollicité par les responsables religieux de Conakry. « La veille déjà, raconte l’un de ces religieux, nous avions négocié avec Dadis jusqu’à deux heures du matin pour que la manifestation soit autorisée mais encadrée. Le président a refusé. Il souhaitait que la marche ait lieu le lendemain, le 29, à Nongo, en banlieue. » L’archevêque monseigneur Coulibaly, l’archevêque monseigneur Gomez et l’imam de la Grande Mosquée, Ibrahima Bah, ont alors essayé de convaincre l’opposition de changer de programme. Sans succès.
« Il n’était pas question qu’on demande aux gens de sortir et que nous nous retrouvions dans une cour, en toute sécurité, en abandonnant la population dans la rue », résume Bah Oury, responsable du Comité d’organisation du rassemblement.
Les principaux leaders de l’opposition quittent le domicile de Jean-Marie Doré avant même l’arrivée des responsables religieux. « Nous connaissions leur message, raconte l’opposant Mouctar Diallo, c’était pour nous demander de reporter la manifestation. Nous nous sommes levés, Jean-Marie Doré est resté. »
À quelques centaines de mètres du stade, devant l’Université Gamal Abdel Nasser, les opposants sont bloqués par un barrage de policiers et de gendarmes. Peu de temps après, arrive le colonel Tiegboro. Il répète que le rassemblement ne peut pas avoir lieu. Discussion animée, tendue même par moments, mais contrairement à ce qu’affirme le proche de Moussa Tiegboro Camara, les opposants n’ont jamais accepté de reporter la manifestation.
Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée), raconte que le colonel s’est absenté quelques minutes et qu’à son retour, il a demandé aux forces de l’ordre de céder le passage aux opposants. Les portes du stade ont été ouvertes et la foule a commencé à prendre place dans les tribunes, sur le terrain, dans les allées.
« Il y avait beaucoup d’ambiance, raconte une manifestante, ça chantait, ça dansait. Certains ont même prié sur la pelouse. C’était la joie ! »
Le rassemblement de l’opposition est un succès. Des milliers de personnes ont répondu à l’appel et se massent dans le stade dans une ambiance de fête.
Jean-Marie Doré rejoint les autres responsables de l’opposition un peu avant midi. Selon l’un de ses proches, l’opposant pensait alors convaincre les autres responsables politiques de renoncer au rassemblement, « mais c’était impossible, le stade était archi-comble ». Jean-Marie Doré rejoint la tribune officielle.
Faute de matériel de sonorisation, les leaders politiques ne prononcent pas de discours mais devant les journalistes présents dans les gradins, ils se félicitent de l’ampleur de la mobilisation.
Quelques minutes seulement après l’arrivée de Jean-Marie Doré, on entend les premiers coups de feu.
Le piège
« Le stade était plein, raconte Fanta, une manifestante. Il n’y avait plus de place pour s’asseoir. Dès que les leaders sont arrivés, tout le monde a tapé dans ses mains en criant «Changement, changement !» Quand on a entendu les premiers coups de feu, on pensait que c’étaient des pétards. »
Les rares images tournées avec des téléphones portables montrent l’incompréhension totale des manifestants. Dans les allées qui entourent le stade, les gaz lacrymogènes surprennent la foule. Ce n’est qu’au moment où les coups de feu retentissent que les manifestants commencent à courir.
Les forces de sécurité entrent par le grand portail, le seul accès à la rue, puis ils encerclent les lieux et entrent à l’intérieur du stade. Une fois sur la pelouse, ils tirent indistinctement sur la foule. Les manifestants ont vu des bérets rouges, commandos de parachutistes et membres de la Garde présidentielle, mais aussi des gendarmes et des hommes en civil, qui eux portaient des armes blanches et poignardaient tous ceux qui se trouvaient sur leur passage.
« Il y a eu une débandade indescriptible, se souvient Mouctar Bah, journaliste pour Radio France internationale et l’agence France-Presse. Les gens sont descendus des gradins pour essayer de sortir. Ils montaient sur des murs de quatre mètres, cinq mètres ! D’autres sont restés où ils se trouvaient parce qu’il n’y avait nulle part où aller. »
Les militaires bloquent toutes les sorties du stade, les deux portes principales et les issues secondaires. De très nombreux manifestants ont été blessés en essayant de franchir les grilles qui séparent les gradins de la pelouse et des escaliers. Certains sont morts dans le mouvement de foule, écrasés contre les grilles ou piétinés dans la cohue.
Pour ceux qui réussissent à sortir du bâtiment, le soulagement ne dure pas longtemps. Les militaires sont partout et poursuivent les manifestants en fuite.
« Je suis allée vers le stade annexe, raconte Saran, militante du parti d’opposition UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée). Un jeune m’a aidée à monter sur le mur. Ils lui ont tiré dessus, au milieu du front. Lorsque le petit est tombé, j’ai basculé dans la cour de l’autre côté du mur. Nous étions plusieurs. Des militaires et des policiers sont arrivés. L’un d’entre eux m’a frappée avec un morceau de caoutchouc et j’ai perdu connaissance. »
Comme Saran, beaucoup de manifestants ont essayé de franchir les murs qui entourent le stade mais des militaires, postés de l’autre côté, mettaient en joue ceux qui essayaient de sauter.
« Il y a une porte au fond, vers l’université. On voulait sortir par-là, mais quand on est arrivé, les policiers habillés en noir et cagoulés ont tiré les fils de courant. Ils ont vu que les personnes qui arrivaient en face étaient plus nombreuses qu’eux alors ils ont fait tomber les fils. Les premiers manifestants qui ont essayé de passer ne se sont pas relevés. Ils ont été tués par le courant électrique. »
Plusieurs témoins rapportent que les forces de l’ordre avaient sectionné des fils électriques pour empêcher les manifestants de s’enfuir : « Des jeunes sautaient. Ils ont attrapé les fils électriques au-dessus du portail et certains ont été électrocutés. Quand tu mets ta main, le courant te prend. Il y a des gens qui sont morts comme ça ! »
Les responsables de l’opposition stupéfaits… Et matraqués
On a vu les hommes en tenue, et d’autres qui n’étaient même pas en uniforme, qui commençaient à tuer comme ça. On a compris petit à petit que c’était un massacre.
Du haut de la tribune officielle, les responsables de l’opposition ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe, comme le raconte Mouctar Diallo, leader des Nouvelles forces démocratiques : « Nous avons commencé à entendre des coups de fusil, à voir la fumée des gaz lacrymogènes, mais jamais bien sûr nous n’aurions pu imaginer que cette barbarie était possible.
On a vu les hommes en tenue, et d’autres qui n’étaient même pas en uniforme, qui commençaient à tuer comme ça. On a compris petit à petit que c’était un massacre. Nous, nous étions là stupéfaits à la tribune. »
« C’était de la pure folie, résume Sydia Touré. Nous avons décidé de ne pas bouger, mais à un moment, des militaires sont venus nous demander de descendre. J’étais le premier, j’ai pris d’abord une gifle. Quand je me suis redressé, un des militaire qui avait un bâton a visé ma tête.
J’avais la tête complètement ensanglantée, je titubais un peu. Quand je suis arrivé sur le gazon, je suis tombé. Je voyais Cellou Dalein Diallo à côté qui s’était recroquevillé et qui recevait des coups de pieds. »
Oury Bah se souvient qu’un groupe de militaires s’est dirigé directement vers les responsables de l’opposition. « C’est Toumba, commandant de la Garde présidentielle, qui conduisait ce peloton de bérets rouges. Il y a eu des matraques, des échanges de coups. Il n’est pas resté longtemps, c’est comme s’il était venu pour prendre un certain nombre de personnes. »
Mouctar Diallo raconte que le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité, l’aide de camp du président Dadis, a protégé les leaders politiques. « Toumba nous a demandé de le suivre. Quand nous sommes arrivés sur la pelouse, on continuait à recevoir des coups. Un de ceux que j’ai reçus a failli me faire évanouir. Je suis tombé mais je me suis relevé tout de suite parce que je me suis dit : «Si je reste là une seconde, ils vont me tuer.» Il y avait Sidya Touré devant, François Fall et moi. On s’était accrochés l’un à l’autre, très fermement. Je pense que Cellou était derrière nous et qu’il était tombé au sol sous les coups. Il y avait Bah Oury à côté de lui. Nous avons continué, Toumba nous a guidés pour sortir du stade. Je pense qu’il s’inquiétait de notre sort. Nous sommes sortis par l’entrée principale, sa voiture était garée de l’autre côté de la route. Il nous a mis dans son véhicule puis s’est absenté quelques minutes.
Pendant ce temps, Marcel, le neveu de Dadis qui était en même temps l’adjoint de Toumba, est venu avec un gros bâton du côté de la portière où se trouvait Sidya Touré. Il a dit «Bâtards, on va vous tuer aujourd’hui.»
C’est à ce moment qu’on a vu Jean-Marie Doré trimballé et tout couvert de sang, les habits déchirés. Lui, on l’a mis dans le véhicule qui était derrière nous, je crois que c’était celui de Tiegboro. »
Le colonel Moussa Tiegboro Camara a pris en charge les autres leaders de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, Jean-Marie Doré et Oury Bah.
Une source proche du colonel Tiegboro résume son intervention : « Le seul objectif, c’était les leaders politiques. En arrivant au stade, il a vu Cellou Dalein Diallo, qui avait déjà été frappé, et il s’est dit : «S’il est tué, on est foutus. Ça aurait pu être la guerre civile.» Le colonel Tiegoboro n’a pas passé plus de quinze minutes là-bas, il a mis Cellou Dalein Diallo, Bah Oury et Jean-Marie Doré dans sa voiture et il est parti. »
Selon cette source, c’est le colonel Tiegboro, et lui seul, qui a pris l’initiative de faire sortir les leaders de l’opposition, sans concertation avec aucun responsable de la junte.
« Lorsque Toumba a appris qu’il était là, il a fait semblant mais au départ, il ne souhaitait pas aider l’opposition. C’est lui qui commandait les bérets rouges. »
Le seul objectif, c’était les leaders politiques
Pour quelle raison Toumba et Tiegboro ont-ils décidé de sauver les chefs de l’opposition ?
Au cours de l’enquête, dans ses déclarations aux juges, l’aide de camp Aboubakar Toumba Diakité explique s’être rendu au stade pour chercher le président. Il affirme être parti seul au stade, une version contredite par plusieurs manifestants qui l’ont vu arriver à la tête d’un groupe de bérets rouges.
Selon plusieurs témoignages et les déclarations de Moussa Dadis Camara lui-même, le chef de l’État se trouvait pourtant au camp Alpha Yaya ce matin-là, où les principaux responsables de la junte avaient établi leurs quartiers. Toumba, lui, assure qu’il le pensait au stade, qu’il s’est rendu sur place pour l’alerter mais qu’en voyant la gravité de la situation, il a décidé d’intervenir pour exfiltrer les leaders politiques.
Le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité s’appuie d’ailleurs sur cette intervention pour se défendre de toute implication dans la répression du 28 septembre. Actuellement en détention préventive et désigné comme responsable par son ancien président, il assure n’avoir jamais donné l’ordre de tirer sur la foule.
Selon Mamadi Kaba, directeur de l’Institution nationale indépendante des droits humains, Toumba et le colonel Tiegboro ont bien agi de leur propre chef pour sauver les chefs de l’opposition, mais cela ne les disculpe pas pour autant. « Ils savaient qu’il y aurait une répression, d’ailleurs ils ont envoyé leurs hommes. Ils ne savaient peut-être pas forcément que cela irait jusque-là, mais ils étaient au courant.
Il faut voir leur choix de sortir les leaders comme des initiatives personnelles qui permettaient d’éviter le pire, dans l’intérêt du grand chef. Pour peut-être lui dire ensuite que leur geste avait permis de sauver son régime. »
L’exfiltration des responsables de l’opposition
Les deux véhicules, conduits par le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité et le colonel Tiegboro, quittent le stade en direction de la clinique Ambroise Paré, à moins de dix minutes de route. Avant que les leaders de l’opposition ne commencent à recevoir des soins, avant même que certains n’aient le temps de sortir de voiture, un groupe de bérets rouges débarque à la clinique. À leur tête, Marcel Guilavogui, adjoint de Toumba et présenté comme le neveu du président Dadis. Plusieurs témoins racontent la scène : grenade à la main, Marcel menace de tout faire sauter, crie que les opposants doivent être tués.
Le même Marcel Guilavogui a déclaré aux juges d’instruction guinéens en 2010 qu’il ne s’était pas rendu au stade le jour du massacre et assuré qu’il était resté alité toute la journée à cause d’un accident de circulation survenu quelques jours plus tôt.
À cause des menaces, les voitures transportant les opposants repartent et se dirigent cette fois vers la gendarmerie, en centre-ville. « Le chef d’état-major de la gendarmerie est venu pour donner les instructions, explique Mouctar Diallo des Nouvelles forces démocratiques. Il a ordonné qu’on nous donne les premiers soins. Puis Tiegboro est venu nous trouver pour nous dire que Dadis lui a donné instruction de nous prendre nous et Cellou, qui était au camp Samory, et de nous conduire à la clinique Pasteur. Nous étions tous dans la même salle pour les soins. C’était encerclé. On n’avait même plus de moyens de communication. »
Viols et tortures
Au stade, les militaires ne cessent de tirer qu’après avoir épuisé leur stock de munitions, mais continuent de traquer les manifestants. Les forces de sécurité et les hommes en civil équipés d’armes blanches poursuivent leur massacre.
Pendant plusieurs heures, ils se sont livrés à des violences jamais vues en Guinée. En plus des meurtres qui ont causé la mort de 157 personnes, au moins une centaine de viols ont été commis publiquement. Peut-être davantage, de nombreuses femmes refusant toujours de témoigner, craignant d’être stigmatisées.
L’une d’entre elles connaissait son agresseur, qu’elle a dénoncé depuis. « J’ai croisé un gendarme qui travaillait ici à Hamdallaye. Il nous connaissait. Il m’a frappée sur les deux joues avec son fusil, puis sur la tête. Je suis tombée. Il a frappé jusqu’à ce que je ne puisse plus me relever puis iI a pris un couteau et a déchiré mes habits. Il m’a aussi fait une croix dans le dos avec le couteau. Il m’a violée. Il a appelé deux hommes, bérets rouges. Je ne me souviens pas de la suite, j’ai perdu connaissance. »
Aissatou, une autre femme âgée de 25 ans au moment des faits, était venue au stade avec l’une de ses amies qu’elle a perdue dans sa fuite. « Je me suis cachée au niveau des toilettes, dans les gradins. Quelques instants après, quatre militaires sont venus. L’un d’entre eux m’a tirée sur une sorte de banc. Ils ont d’abord déchiré mon pantalon. Le premier m’a violée, le second m’a violée. Le troisième a essayé mais là, j’ai résisté un peu alors ils m’ont cognée sur la tête et j’ai perdu connaissance. »
De nombreuses femmes ont été violées à plusieurs reprises, plusieurs avec des objets, puis laissées pour mortes par leurs agresseurs.
Aissatou n’a repris conscience qu’en fin d’après-midi. Elle a été sauvée par un militaire qui, après lui avoir donné un pantalon, l’a placée au milieu d’un groupe d’hommes et de femmes qu’il conduisait vers la sortie. « Pendant qu’on marchait, d’autres militaires se sont approchés. Ils ont demandé à deux jeunes garçons du groupe de leur donner leurs téléphones. Le premier a donné son téléphone et à bout portant, ils ont tiré sur lui. Ils ont demandé aussi au deuxième. Ce dernier a dit : ‘‘Si vous me tuez, vous allez me tuer avec mon téléphone.» Les militaires ont tiré et il est tombé sur moi.
Pendant tout ce temps, les militaires nous disaient de rire à nous, les femmes, ils nous disaient d’être contentes. Ils nous ont forcées à rire. Comme je refusais, l’un d’entre eux a pointé son arme sur moi, puis il a appuyé son arme sur mon oreille et il a tiré dans le vide. »
L’opposant Sidya Touré se souvient avoir assisté à des scènes de viol en quittant le stade. « Je voyais des femmes dans des situations que je n’ose pas décrire. J’ai le regard d’une femme qui ne me quittera jamais. Elle voulait protéger sa dignité. Je vous assure que ça vous marque toute votre vie. »
Contrairement à ce qu’affirment de nombreux témoignages, Aboubakar Toumba Diakité et Moussa Tiegboro Camara, les responsables militaires ayant aidé les leaders de l’opposition à s’échapper du stade, assurent tous les deux n’avoir vu aucun viol ce jour-là.
Mamadi Kaba, directeur de l’Institution nationale indépendante des droits humains est certain que ces viols faisaient partie du plan de répression du rassemblement. « Il y a eu un ordre donné pour qu’ils violent. Sinon, il y aurait peut-être eu deux ou trois cas mais pas une centaine de femmes. Il y a eu un ordre.
En Guinée, quand les femmes se mêlent à une manifestation, elle prend une autre dimension. Il y a une fête que l’on célèbre chaque année, pour commémorer un jour où les femmes se sont mobilisées contre le régime de Sékou Touré [chef de l’État guinéen de l’indépendance à 1984]. Tous les présidents ont en tête que les femmes sont capables de les braver, alors si vous voulez tuer l’esprit de révolte, il faut taper dur sur les femmes. Je crois que c’est ce qui s’est passé. Je crois que l’esprit qui a guidé la répression, c’est la terreur afin qu’elles n’aient plus jamais le courage de manifester contre le CNDD. »
En Guinée, quand les femmes se mêlent à une manifestation, elle prend une autre dimension. (…) Tous les présidents ont en tête que les femmes sont capables de les braver, alors si vous voulez tuer l’esprit de révolte, il faut taper dur sur les femmes.
Le calvaire s’est prolongé pour certaines femmes, enlevées au stade et violées pendant plusieurs jours après le 28 septembre. « Alors que j’essayais de fuir le stade, un policier est venu me terrasser. Je suis tombée et j’ai perdu connaissance.
Quand je me suis réveillée, je me trouvais dans une maison, il n’y avait personne. J’entendais l’eau, comme la mer, mais je ne voyais pas les alentours. On m’avait mise dans une chambre sans électricité, sans fenêtre, j’étais dans le noir sur une natte. L’homme est entré, il avait une tenue verte. Il m’a déshabillée. Il me faisait ce qu’il voulait, il filmait …
Il m’a dit que si je pleurais, il me tuerait alors je n’ai pas pleuré. Il s’est allongé sur moi… je faisais ce qu’il voulait. Il m’a forcée. Il est venu plusieurs fois, deux jours de suite.
Je n’ai rien mangé, rien bu. J’avais peur qu’il me tue, je pensais à mon bébé à la maison et à mon mari… ma tête tournait.
Mardi, il a apporté quelque chose pour m’attacher les mains. Ce n’était pas serré mais je ne pouvais pas bouger comme je le voulais. Il m’a donné des habits, m’a mise dans un camion et m’a conduite jusqu’au quartier de Hamdallaye. Il m’a fait descendre et il a disparu. »
Dienabou, elle, a été conduite avec plusieurs autres filles au camp Koundara, probablement droguée. Elle s’est retrouvée vers minuit dans une salle du camp militaire. « Moi, j’étais vierge, je ne connaissais rien. On m’a fait monter jusqu’au troisième étage. Il y avait plusieurs militaires, ils étaient quatre. Ils nous ont violées, ils nous ont frappées, on nous a aussi coupées avec des couteaux, explique-t-elle en montrant d’épaisses cicatrices sur ses bras. On nous a fatiguées là-bas. Vers trois heures ou quatre heures du matin, on nous a déposées à l’hôpital Donka avec mes deux copines. »
Les victimes souffrent encore aujourd’hui des viols et des sévices subis au stade le 28 septembre, leurs corps portent les séquelles des agressions sexuelles, nombre d’entre elles ont été abandonnées par leur mari et vivent aujourd’hui dans des conditions très difficiles, la stigmatisation est très forte. La jeune Aissatou n’a même pas voulu faire établir de certificat médical à l’hôpital : « J’ai dit aux médecins de n’en parler à personne. Je n’ai rien dit à ma famille. Je ne voulais pas que les gens au quartier disent que j’étais parmi les filles violées au stade. Ça peut faire qu’on ne trouve pas de mari, même sans raconter tous les détails. Plusieurs fois, des hommes m’ont demandée en mariage mais dès qu’ils ont su que j’avais été au stade, l’histoire s’est arrêtée. Ils ne sont plus jamais revenus. »
Au milieu de ce déchaînement de violences, quelques individus ont tenté de sauver des manifestants. Fanta, une femme d’une cinquantaine d’années, a été cachée par un jeune inspecteur de police avec plusieurs autres femmes dans une cour un peu excentrée. « Au bout de deux ou trois heures, je voulais sortir. Le jeune inspecteur m’a dit : «Ne va nulle part, ils sont en train de violer les femmes dans les salles de jeu.» J’ai dit : «À mon âge ?» Il m’a répondu : «Pire que ça.» Je suis restée près de lui.
Pendant ce temps, ça tirait, ça tirait. Les gens criaient. Il fallait voir les cadavres…
Nous sommes sorties en groupe mais au bout de quelques minutes, j’ai aperçu un homme avec un couteau. Dès que je l’ai vu, je me suis cachée. Je suis restée là, les cadavres étaient à terre. Des véhicules sont arrivés pour prendre les corps. Des véhicules militaires. »
Fanta ne veut pas en dire davantage. Plusieurs années après les événements, elle craint toujours des représailles.
Dissimulation des corps
Les autorités guinéennes ont toujours nié avoir fait disparaître des corps et n’ont entrepris aucune recherche concernant de probables fosses communes. Aujourd’hui encore, aucune investigation officielle n’a été menée sur les sites évoqués par plusieurs témoins.
Pourtant, un manifestant raconte que des militaires ont bien fait disparaître des corps le 28 septembre. Le jeune homme, qui préfère rester anonyme, a été blessé au stade. Il n’avait pas trente ans.
« Je ne sais même pas par quoi j’ai été blessé, mais j’ai été touché à la tête et j’ai perdu connaissance pendant longtemps. Je n’ai repris conscience que là où ils ont commencé à jeter les gens, il faisait nuit. » Il poursuit : « Ils ramassent les corps, ils les mettent dans le camion. Je reviens à moi, tout est en sang. Je suis dans le camion. Avec les morts. »
Il pleure. « Je ne voyais rien. C’est les morts. Je suis avec les morts ! »
Le jeune homme s’interrompt. Il regarde devant lui et se tait pendant de longues minutes, n’ouvrant la bouche qu’au passage d’un véhicule militaire à quelques mètres : « Tiens, il y a des bérets rouges ici… »
Il reprend son récit, les yeux dans le vague : « Je ne sais pas où nous étions. Les militaires étaient en train de débarquer les corps. Quand l’un d’entre eux a braqué sa torche vers moi, je me suis mis au garde à vous. J’ai dit pardon. Il a crié : «Il y en a un qui n’est pas mort !» Un autre a dit : «Mettez-le dans le trou.» Ils ont discuté chaudement et ont finalement décidé de me laisser là. Je suis resté dans le camion. Ils ont bien bloqué pour que je ne puisse pas sortir et fuir. »
Le jeune homme s’interrompt de nouveau pendant un long moment avant de reprendre. « Ils m’ont ramené chez le président Dadis, au camp Alpha Yaya. Je criais, je devenais fou. Le lendemain, en pleine nuit, ils m’ont jeté par-dessus le mur, derrière la cour. J’avais des vêtements, mais pas de chaussures. Du sang partout. C’est mon sang ou c’est le sang des morts ? »
Trois semaines après le massacre du 28 septembre, un militaire a confirmé l’existence de fosses communes sur Radio France internationale. Sous couvert d’anonymat, ce béret rouge assure avoir reçu l’ordre de faire disparaître des cadavres : « Dans la nuit du lundi, ils nous ont dit d’aller récupérer les corps. On en a récupéré quarante-sept, qui ont été enfouis, mais je ne peux vraiment pas vous dire où exactement. »
Un haut-gradé de l’armée confirme, sans donner de chiffres, que les militaires ont enterré de nombreux corps dans les heures qui ont suivi le massacre.
Plusieurs familles n’ont jamais retrouvé les corps de leurs proches. Selon les chiffres des Nations unies, on a perdu la trace de 49 personnes qui s’étaient rendues au rassemblement de l’opposition et 40 autres ont été vues mortes au stade ou dans les morgues mais leurs corps ont ensuite disparu.
Le jour du massacre, les blessés et les cadavres ont été transportés dans la cohue, dans des ambulances envoyées par les hôpitaux et la Croix-Rouge, et parfois dans des véhicules privés.
L’un des responsables religieux ayant participé aux négociations avec les autorités guinéennes et l’opposition raconte avoir transporté des corps dans sa voiture personnelle.
La plupart ont été déposés à la Grande Mosquée de Conakry pour une prière, puis inhumés au cimetière Cameroun, certaines familles ont préféré emmener les dépouilles de leurs proches dans les quartiers pour organiser des funérailles.
De la Grande Mosquée Fayçal, où il a passé une partie de la journée, ce responsable religieux a vu les militaires bloquer l’entrée de la morgue de l’hôpital Donka. « Je ne me souviens plus quand exactement. Les enterrements ont commencé vers 16 heures donc ça devait être vers 14-15 heures. Je n’ai pas vu de camions mais il y avait des militaires dans l’enceinte de l’hôpital, des bérets rouges et d’autres corps de l’armée. »
Le lendemain, en pleine nuit, ils m’ont jeté par-dessus le mur, derrière la cour.
J’avais des vêtements, mais pas de chaussures. Du sang partout. C’est mon sang ou c’est le sang des morts ? »
D’autres témoins rapportent que les militaires ont pris le contrôle de la morgue de l’hôpital Donka, qui se trouve à quelques minutes seulement du stade et qui a accueilli la plupart des blessés et des corps.
L’accès a été interdit aux familles. Les corps des victimes ont été présentés plusieurs jours plus tard, le 2 octobre à la Grande Mosquée. Comme le souligne le rapport de la Commission d’enquête des Nations unies, « aucune méthodologie correcte d’identification des corps n’a été appliquée. Les personnes décédées ont été complètement déshabillées, alors que certaines portaient des objets personnels, mais aucun registre n’a été établi, aucune photographie n’a été prise. Le nombre insuffisant de chambres froides et l’absence de préparation correcte des corps, par manque de formol, associés à la température élevée de septembre, ont conduit à une dégradation rapide des cadavres. » Lorsqu’ils ont été exposés, quatre jours après le massacre du stade, de nombreux corps n’étaient plus identifiables.
Un homme d’une quarantaine d’années a perdu son frère. Un membre de leur famille l’a vu mort, aligné auprès d’autres victimes sur l’esplanade à l’entrée du stade, mais son corps ne se trouvait pas à la mosquée Fayçal le 2 octobre et les recherches lancées depuis n’ont jamais rien donné.
Les militaires à l’hôpital
De nombreux témoignages assurent que les militaires ont également pénétré dans les unités de soins de l’hôpital Donka dans l’après-midi, pour menacer les blessés.
Thierno se trouvait aux urgences, un bras cassé, lorsqu’il a vu des bérets rouges entrer. « Il était environ 16 heures, un camion s’est garé au portail. Les militaires ont commencé à bastonner les gens, y compris certains blessés qui ne pouvaient pas se déplacer. Ils ont insulté les patients et dit qu’il ne fallait pas nous donner de médicaments. Je n’osais pas les regarder dans les yeux. Ensuite, le ministre de la Santé, Diaby, est arrivé. Il demandait : «Qui vous a dit de sortir manifester ?» Le ministre de la Santé n’a pas insulté, c’étaient les bérets rouges qui insultaient les gens. Il n’a pas frappé non plus. »
Un proche d’Abdoulaye Chérif Diaby confirme que le ministre s’est bien rendu aux urgences, mais pour évaluer la situation, soutenir les médecins. Il dément la présence de militaires sur place.
La libération des responsables de l’opposition
Dans la soirée du 28 septembre, les opposants sont invités à quitter la clinique Pasteur et à rentrer chez eux, à l’exception de Cellou Dalein Diallo et Jean-Marie Doré, dont les blessures étaient plus importantes.
« Quand je suis arrivé, se souvient Sidya Touré de l’Union des forces républicaines, je n’avais plus de chez moi. Ils avaient tout détruit, tout saccagé. Il n’y avait plus aucun poste de télévision, plus aucun téléphone, aucune radio… tous les appareils ménagers avaient été ramassés, mon coffre-fort, dans lequel se trouvaient tous mes documents, tout était parti. La maison était renversée dans tous les sens. Les quatre véhicules avaient été embarqués. »
Situation analogue chez Cellou Dalein Diallo, comme le raconte l’un des responsables du maintien de l’ordre de l’UFDG. « Quand j’ai réussi à fuir le stade, je suis allé au domicile de mon patron. J’ai vu des bérets rouges qui venaient. Quatre pick-up. Je suis tombé, la moto m’a brûlé la jambe et mon pied s’est cassé. Comme j’étais couché, ils ont cru que j’étais mort, ils m’ont laissé. Les militaires sont rentrés, ils ont cassé tout ce qui se trouvait dans la maison, et emporté tout ce qu’ils pouvaient prendre. Les motos, les voitures, les valises… Ils ont chargé les 4 pick-up, remplis. »
Pillages, pressions, arrestations
Les pillages ne se sont pas limités aux domiciles des responsables politiques, ils avaient commencé au stade où les manifestants ont été systématiquement dépouillés de leur argent et de leurs téléphones portables. Ceux qui réussissaient à s’enfuir étaient stoppés au portail par des policiers qui les ont rackettés.
Dans tous les quartiers de la capitale, connus pour être favorables à l’opposition, les forces de l’ordre ont pénétré dans les maisons, ont dévalisé des commerces, pendant plusieurs jours. Cinquante commerçants établis au carrefour Cosa ont porté plainte pour pillage.
Plusieurs témoins disent avoir vu les jours suivants le capitaine Pivi, alors ministre de la Sécurité présidentielle, et ses hommes commettre des exactions.
Les militaires ont également retenu des prisonniers dans différents camps de la capitale, dont le camp Alpha Yaya où résidait l’état-major du CNDD. Mamadou, rescapé du stade, sans nouvelles de son neveu le lendemain du massacre, appelle sur son téléphone portable. Un militaire lui apprend qu’il est détenu. Mamadou se rend alors au camp Koundara pour demander la libération de son neveu : « Ils nous ont fait entrer au camp et dès que nous avons été à l’intérieur, ils nous ont attrapés, déshabillés totalement et ils nous ont blessés. Ils ont versé de l’eau chaude sur nous, roulé sur nos jambes avec des motos. J’étais avec mon grand-frère, il est décédé, il n’a pas pu résister.
Tous les jours, matin et soir, ils nous mettaient à terre pour nous frapper, cinquante coups chacun. Ils nous frappaient avec du bois ou du caoutchouc. Ils nous insultaient, ils versaient de l’eau chaude sur notre corps. Toute la peau du haut de mon dos est partie. Ils avaient récupéré tous nos vêtements.
Le 4ème jour, deux amis sont venus pour voir s’ils pouvaient nous faire sortir. Eux aussi ont été récupérés et l’un des deux est décédé également.
Notre détention, c’était difficile. La nuit, ils menaçaient de nous tuer et de nous jeter à la mer. Tous les jours, ils buvaient de l’alcool et fumaient de la drogue devant nous, ils recevaient des filles, certaines avaient été enlevées au stade, d’autres étaient des prostituées. Puis ils nous disaient : «Mettez-vous en sardine», c’est-à-dire l’un sur l’autre. Tout le monde, comme dans une boîte de sardines. On devait rester comme ça quelques minutes et ils disaient «encore» alors ceux qui étaient en bas changeaient de place avec ceux qui étaient en haut.
On a dû verser de l’argent pour sortir. Chacun d’entre nous a payé un million de francs. »
Le grand absent
À aucun moment, le président de la junte n’a été vu au stade. Lors de son audition par les juges d’instruction guinéens en février 2013, Moussa Dadis Camara a expliqué s’être couché tard la veille et avoir été informé vers 10 heures que la manifestation était en cours. Alors que, selon ses dires, il comptait « user de la sympathie qu’avait la population à [son] égard pour essayer de la calmer », son entourage l’en aurait dissuadé.
Toujours selon ses déclarations de 2013, Moussa Dadis Camara a appris plusieurs heures plus tard que des massacres étaient en cours et que des manifestants avaient été tués. Il assure avoir été « révolté » et prétend n’avoir jamais donné la moindre instruction.
Un proche du colonel Tiegboro, des services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme, raconte qu’en fin d’après-midi, ce dernier s’est rendu au camp Alpha Yaya. « Le colonel a fait un compte-rendu au chef de l’État vers 16-17 heures. Le président a pleuré. Il est trop sentimental, Dadis. Il a dit : «Et bon Dieu, que faire ?»
Dadis était déjà au courant qu’il y avait un problème mais il ne savait pas quoi. Il était étonné lorsque le colonel lui a dit que des opposants étaient blessés. »
Moussa Dadis Camara s’est aussi peut-être inquiété pour son avenir, comme le laissent entendre les propos qu’il a tenus devant les juges d’instruction en 2015 : « J’étais à mon bureau en larmes. Voyant tout le poids qui pesait sur ma tête. Je me voyais même perdu à cause de ce qui venait d’arriver et de ce que je représente comme autorité morale. »
Moussa Dadis Camara assure avoir été victime d’un complot visant à le décrédibiliser et le destituer, il accuse son ancien aide de camp, Aboubacar Toumba Diakité. Selon lui, Toumba avait trop d’assurance, « il prenait souvent des initiatives sans m’en aviser. »
Lors de son audition par les juges d’instruction en 2015, le chef de la junte a expliqué avoir voulu faire arrêter son aide de camp, Aboubakar Toumba Diakité, mais en avoir été dissuadé par ses collaborateurs. « Je vous signale que c’est lui qui détenait les clefs de la poudrière. À vouloir le tenter, il fallait s’attendre à beaucoup de morts collatéraux. En voulant l’arrêter, il m’aurait achevé. Il était le commandant de régiment de la Garde présidentielle. Il avait à sa disposition les hommes et les armes. Je ne pouvais qu’obéir. »
D’anciens responsables du CNDD racontent exactement l’inverse. Selon eux, plusieurs officiers supérieurs ont tenté d’arrêter le lieutenant Toumba dans les jours suivant le massacre, mais en ont été empêchés par le président qui est ensuite apparu publiquement aux côtés de son aide de camp à l’occasion de la fête de l’indépendance, le 2 octobre, soit quatre jours après les événements.
De plus, la Commission d’enquête des Nations unies souligne dans son rapport : « Le président s’est plaint de son armée indisciplinée. Toutefois, il a également démontré un haut degré de contrôle sur les militaires puisque l’armée régulière a obéi à ses ordres, transmis par l’intermédiaire du chef de l’état-major des armées, de rester dans les casernes toute la journée malgré la gravité des événements qui se déroulaient en ville. »
Une junte divisée
De nombreux anciens membres du CNDD s’accordent à dire que l’atmosphère n’était pas sereine au sein de la junte.
Les membres du CNDD avaient parfois du mal à joindre leur président. « Il n’aimait pas beaucoup le téléphone, se souvient l’ancien ministre Tibou Kamara, devenu ministre d’État et conseiller de l’actuel président Alpha Condé, et on ne travaillait que la nuit. » L’un des religieux ayant tenté de mener une médiation entre l’opposition et le pouvoir se souvient avoir attendu parfois cinq ou six heures avant d’être reçu par Moussa Dadis Camara.
Un ancien responsable de la junte raconte également que les militaires au pouvoir n’étaient pas unis. « Dadis était très populaire au début parce qu’il distribuait des billets de banque. Lorsqu’il était en charge du carburant au sein de l’armée, il n’y a pas un militaire qui n’a pas «mangé» [reçu de l’argent]. Mais trois mois après la prise du pouvoir, on a senti beaucoup de dissensions, la frustration se lisait sur le visage de chacun. » Il ajoute que le président décidait souvent seul. « Il était impulsif. Il pouvait prendre des décisions sans consulter personne. Après, il lui arrivait de les regretter. » Une autre source décrit le chef de l’État comme un homme influençable, « le dernier à le voir avant de dormir emportait la décision. »
Selon un ancien policier, plusieurs officiers éprouvaient également une certaine rancœur personnelle. « Lorsque Dadis est arrivé au pouvoir, il a mis à la retraite 22 généraux et amiraux et les a remplacés par des jeunes qui, à mon avis, ne méritaient pas ces grades. Il les a choisis plutôt par sentiment qu’en raison de leur compétence. » Le raisonnement vaut aussi pour le président lui-même. À son arrivée au pouvoir, Moussa Dadis Camara n’est que capitaine, âgé d’une quarantaine d’années, et certains officiers n’apprécient pas de devoir obéir à un homme d’un grade inférieur au leur.
Ces conflits d’autorité, ajoutés à des ambitions personnelles, ont créé un climat de méfiance entre les responsables militaires.
« C’était la jungle », résume un haut-gradé de l’armée
Pour plusieurs anciens membres de la junte, le CNDD se résumait à Moussa Dadis Camara et son ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté.
« Le ministre de la Défense était l’homme de confiance du capitaine Dadis, explique Mamadi Kaba, ancien président de l’Institution nationale indépendante des droits de l’Homme, les deux hommes se connaissaient depuis longtemps et Dadis savait qu’avoir le général à ses côtés renforçait la peur chez ceux qui ne soutenaient pas le régime. Les deux hommes constituaient le socle du système du CNDD. »
Sekouba Konaté était en déplacement en Guinée forestière le 28 septembre 2009. Depuis la France, où il vit aujourd’hui en exil, le général s’est exprimé dans la presse pour accuser le président Dadis d’être le principal responsable.
Le ministre de la Défense a-t-il pu ignorer ce qui se préparait ?
Il est difficile d’établir le rôle qu’il jouait au sein de la junte. D’après certains témoignages, le général Sekouba Konaté était très influent. Selon l’ancien ministre Papa Koly Kourouma, le général était régulièrement consulté et très respecté.
Pour d’autres, le général Sekouba Konaté était peu investi dans les activités du CNDD. Un diplomate français le décrit comme un personnage sans envergure, davantage intéressé par l’argent que par le pouvoir, ce que confirme un ancien membre de la junte.
Les rivalités personnelles sont nombreuses. D’anciens membres du CNDD parlent de tensions entre le colonel Tiegboro, à la tête des services spéciaux anti-drogue, et le lieutenant Toumba, commandant de la garde rapprochée du président. D’autres assurent que Toumba et le ministre de la Défense, Sekouba Konaté, se méfiaient l’un de l’autre, tout comme Toumba et le ministre de la Sécurité présidentielle, Claude Pivi…
Pourtant, Papa Koly Kourouma, ancien ministre de l’Environnement du CNDD, assure qu’il n’y avait aucune position contradictoire affichée. Tibou Kamara, ancien ministre de la Communication de la présidence, affirme également qu’aucun désaccord n’était public.
Malgré ces tensions internes, la Commission d’enquête de l’ONU rappelle que les quartiers généraux de tous les responsables militaires se trouvaient au camp Alpha Yaya, dans un rayon de quelques centaines de mètres. Elle en déduit « qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une coordination entre tous les groupes armés impliqués dans l’attaque du stade, y compris les miliciens. »
D’où venaient alors ces miliciens ? Les recrues de Kaleah
De nombreux manifestants disent avoir vu des hommes en civil, équipés d’armes blanches et portant gri-gris et cauris (coquillages utilisés dans les tenues traditionnelle « de protection ») commettre des exactions au stade.
De jeunes opposants à la junte, reçus par l’ambassade des États-Unis quelques semaines avant le massacre, s’inquiétaient déjà d’une éventuelle mobilisation de civils par le régime pour perturber des manifestations. Le résumé de la rencontre figure dans une dépêche diplomatique révélée par Wikileaks. « Ils affirment que le CNDD a envoyé 2 000 jeunes de la région de Guinée forestière [dans le sud-est du pays] à Forecariah [localité du sud-ouest située à 80 km de la capitale] pour y être entraînés et former des escadrons de la mort. » L’ambassade américaine ajoute avoir déjà été avertie de ces recrutements par d’autres sources.
Un militant des droits de l’Homme, contact de longue date et jugé crédible par l’ambassade, alerte lui aussi les diplomates américains, comme en témoigne un document révélé par Wikileaks. Lors d’une rencontre le 10 septembre à l’ambassade, ce militant explique : « Le CNDD prévoit que ces jeunes resteront habillés en civil, mais qu’il les forme à « combattre» d’autres civils. Lorsqu’on lui a demandé des précisions, le contact a déclaré que le CNDD s’attendait à de nouvelles manifestations anti-Dadis, mais ne voulait pas mettre les militaires dans une position où ils pourraient avoir à tirer sur la foule pour maintenir l’ordre. Au lieu de cela, le CNDD veut introduire des «combattants» pro-CNDD dans Conakry pour qu’ils puissent lutter contre les mouvements anti-CNDD qui sont prévus. »
Comme le raconte un ancien membre du CNDD, l’enrôlement a débuté plusieurs mois avant les événements. Des jeunes entraînés à Kaleah expliquent qu’on leur avait promis une intégration dans l’armée, à la fin de leur formation.
« Vous savez, explique l’ancien ministre de la Communication présidentielle Tibou Kamara, lorsqu’un nouveau président arrive au pouvoir, il travaille à sa sécurité et sa protection. Ce n’est pas propre au CNDD. Tous ceux qui viennent recrutent des gens pour la protection du nouveau président. Quand Dadis est arrivé au pouvoir, comme c’était un coup d’État, il n’y avait pas de légitimité démocratique donc le premier réflexe était sécuritaire. Comment se préserver et préserver le régime ?
Donc l’idée de recruter des jeunes pour avoir des fidèles au régime et assurer la protection du président est née et le centre de Kaleah a été ouvert [près de Forecariah]. Pour avoir des gens beaucoup plus sûrs que l’armée dont on avait hérité.»
Selon Aboubakar Toumba Diakité, les tendances communautaristes étaient très fortes au sein de la junte et le président Dadis a demandé aux militaires de son ethnie de recruter des jeunes à Nzérékoré et Macenta, en Guinée forestière.
Mamounan Kpokomou, membre du bureau politique du parti d’opposition UFP (Union pour le progrès de la Guinée), a participé au démantèlement du camp de Kaleah, quelques mois après la chute du régime militaire, en 2010. Il confirme : « Le recrutement avait un caractère sélectif très marqué. Moussa Dadis Camara a recruté uniquement des membres de son ethnie. Tous ceux qui étaient au pouvoir en avaient fait autant. Chaque responsable du CNDD voulait avoir les siens dans les différents corps de l’armée.
Et tenez-vous bien, en plus de leurs parents de la même communauté, ils recrutaient les jeunes contre de l’argent. Dadis est parti faire le recrutement dans les villages qui environnent le sien. Ceux qui sont loin et qui voulaient à tout prix être recrutés ont versé de l’argent. Ca variait entre deux et cinq millions de francs CFA. »
Selon un haut-gradé, Moussa Dadis Camara a recruté 2 000 personnes. Le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, aurait lui aussi fait appel à des jeunes de sa région d’origine, entre 400 et 800 personnes, selon les sources.
Ils ont été conduits au camp de Kaleah et ont reçu leur entraînement militaire. Plusieurs sources affirment que les formateurs étaient d’anciens militaires israéliens et sud-africains. Un haut-gradé parle également d’instructeurs ukrainiens et affirme qu’ils ont apporté beaucoup d’armes en Guinée.
L’entraînement a duré plusieurs semaines, et selon l’aide de camp Aboubakar Toumba Diakité, « le ministre de la Sécurité présidentielle, Claude Pivi, a fait venir à la Présidence 400 jeunes sous prétexte qu’ils étaient venus faire des démonstrations d’arts martiaux. Ils ont été logés par le président avec pour mission de servir de contre-manifestants à l’occasion de troubles. »
Dans le courrier confidentiel daté du 10 septembre 2009 et rendu public par Wikileaks, l’ambassade américaine à Conakry explique que son contact, militant des droits de l’Homme, s’inquiète justement de voir des miliciens infiltrer les rassemblements de l’opposition : « Selon lui, les membres du CNDD recrutent activement des jeunes pour soutenir Moussa Dadis Camara, le président du CNDD, en particulier à l’intérieur du pays. Il a expliqué être préoccupé par le fait que le CNDD déplace ce qu’il décrit comme des «combattants libériens» de la Guinée forestière vers la capitale. Notant que de nombreux témoins ou participants aux guerres en Sierra Léone et au Libéria vivent en Guinée forestière, le contact a déclaré que ces «combattants» sont en fait des mercenaires aguerris. »
Il n’est pas le seul à évoquer ces combattants libériens. L’opposant Jean-Marie Doré a déclaré avoir été menacé au stade par des membres de l’Ulimo.
Sidya Touré, lui aussi, s’interroge sur la présence au stade d’anciens rebelles libériens : « Je n’avais
pas l’impression que c’était des hommes en armes formés, il n’y avait pas du tout de discipline. Par contre, leurs tenues ressemblaient plutôt à celles de combattants de l’époque de Charles Taylor. Ils étaient habillés n’importe comment et ceux-là avaient l’air plutôt agressifs. »
Un haut-gradé estime probable que des membres de l’ULIMO ou des Libériens aient participé à la répression au stade, mais il nuance : « En Guinée forestière, tout le monde est guinéo-libérien. Tout le monde a participé au conflit [la guerre civile au Libéria]. Les anciens de l’ULIMO étaient confondus avec les militaires. Le 28 septembre 2009, ceux qui étaient cagoulés et habillés comme des rebelles étaient mélangés aux autres. » Selon ce haut-gradé, les anciens rebelles n’ont pas été mobilisés en tant que tels, mais faisaient déjà partie des groupes constitués par chacun des responsables de la junte.
La Commission d’enquête des Nations unies estime que ces hommes ont participé directement aux violences, avec des armes blanches, en coordination avec des groupes de bérets rouges, commandos parachutistes dépendant du ministère de la Sécurité présidentielle, et de gendarmes de Tiegboro, le secrétaire d’État à la présidence chargé des services spéciaux de lutte contre le grand banditisme et la drogue.
Éruption de violences ou répression planifiée ?
La Commission d’enquête de l’ONU estime improbable que ces événements aient été le fruit du hasard ou de débordements non-coordonnés : « La nature des actes révèle un niveau de coordination indiquant une intention d’infliger le plus haut degré de souffrance dans un minimum de temps, le tout facilité par le blocage des sorties, de façon à prendre au piège la population ciblée et à maximiser le nombre de victimes. »
Que les autorités aient été débordées le matin du rassemblement ou que la répression ait été planifiée bien avant le 28 septembre, des instructions ont bien été données. L’armée a reçu l’ordre de se rendre au stade, comme l’a raconté un militaire le 17 octobre 2009, sur Radio France internationale : « C’est la gendarmerie qui était d’abord concernée, mais comme elle ne s’est pas entendue avec les opposants, nous avons reçu l’ordre d’aller mater l’opposition. Nous y sommes allés. J’en faisais partie. Nous ne pouvions pas refuser les ordres à savoir, aller mater les opposants, leur faire comprendre qu’il n’y a qu’une seule autorité en Guinée et leur donner une leçon. »
Impunité
La Commission d’enquête des Nations unies déplore dans son rapport que Moussa Dadis Camara n’ait rien fait pour faire cesser les crimes et rien fait non plus pour punir leurs auteurs. Au contraire, un peu plus d’un mois après le massacre, le chef de l’État a promu tous les sous-officiers de l’armée au grade supérieur, « y compris ceux qui faisaient partie des services ayant participé aux événements du 28 septembre, [ce qui] tend à démontrer que leurs actions ont été commises avec l’accord du président. »
Alors que les condamnations internationales se multiplient, la junte cherche à se maintenir au pouvoir. « Le soir du 28, l’indignation générale s’était étendue au CNDD avec en plus un sentiment de peur, de panique même, se souvient l’ancien ministre Tibou Kamara, ainsi qu’une volonté pour beaucoup de réparer, entre guillemets, ce qui avait été fait. Une volonté désespérée de rattraper.
Parce qu’à partir de là, tout le monde s’est posé des questions sur son avenir personnel et sur le régime. Chacun a compris que quelque chose d’extrêmement grave s’était produit. La question de la survie du régime se posait. On a vu les premières divisions, il y a eu vraiment des tensions. Il ne pouvait plus y avoir d’unanimité ou de soutien aveugle. »
Les jours suivants sont confus. Le président de la junte donne plusieurs versions des événements : le lendemain du massacre, dans une interview accordée à Radio France internationale, il parle de bousculades, d’accrochages et laisse entendre que les manifestants auraient pu tirer sur les forces de l’ordre. Il parle ensuite de menace terroriste avant d’imputer la responsabilité de ce qui s’est passé à son aide de camp, Toumba.
Dès que les violences se sont calmées le 28 septembre, les autorités ont cherché à minimiser les événements et effacer les preuves éventuelles. Tous les lieux dans lesquels des violences avaient été commises ont été placés sous contrôle militaire et interdits d’accès. Deux jours après les événements, le stade a commencé à être repeint.
« Les raisons qui ont poussé les autorités guinéennes à intervenir sur ce qui constituait une scène de crime, conclut la Commission d’enquête de l’ONU, ne peuvent s’expliquer que par une volonté d’empêcher l’exploitation des éléments matériels qui pouvaient s’opposer à la thèse des autorités. » Les enquêteurs de l’ONU notent également que « le personnel de l’hôpital Donka [où a été conduite la majorité des victimes] était terrifié à l’idée de communiquer des informations, plusieurs personnes disaient qu’elles avaient reçu la consigne de ne pas parler.» Un silence toujours de mise aujourd’hui.
Moussa Dadis Camara se défend d’avoir voulu couvrir les faits, pour preuve sa décision de faire appel aux Nations unies et d’ordonner la mise en place d’une Commission d’enquête nationale.
Le président a fait part de son intention de créer cette Commission dès le 1er octobre, mais la mise en place a pris plusieurs semaines et, dans l’intervalle, les attributions de la Commission ont été revues. Contrairement à ce qui était prévu, elle ne disposait pas de pouvoirs judiciaires, donc des pouvoirs d’instruction, et ses membres ont été nommés par décret présidentiel.
Dans son rapport, rendu en janvier 2010, la Commission reconnaît que « le contexte de crise a jeté la suspicion et la méfiance quant à sa crédibilité » et admet ne pas avoir pu interroger le président Moussa Dadis Camara et son aide de camp, Aboubakar Toumba Diakité, « qui figuraient pourtant au programme de la CNEI (Commission nationale d’enquête indépendante). »
Le bilan de la Commission nationale fait état de 63 morts, un chiffre bien inférieur à celui établi par les Nations unies qui parlent de 157 victimes.
« La violence est une culture politique dans notre pays », explique Tibou Kamara, ex-ministre du CNDD et aujourd’hui conseiller du président Alpha Condé. Mais cette violence n’est jamais punie.
Aujourd’hui, les victimes vivent toujours dans la peur, beaucoup d’entre elles préfèrent rester anonymes. Les militaires, eux, n’ont pas été inquiétés.
Après huit longues années d’attente, la justice guinéenne a enfin clôt l’instruction. Douze personnes ont été formellement inculpées par la justice guinéenne, dont Moussa Dadis Camara, son ancien aide de camp Toumba ou le colonel Tiegboro. Hormis l’ancien président, qui vit aujourd’hui en exil au Burkina-Faso, et le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité, détenu à la prison centrale de Conakry, les autres inculpés vivent en Guinée, libres. En attendant l’ouverture du procès, sans cesse retardée, certains anciens membres du CNDD, comme le colonel Tiegboro ou Claude Pivi, occupent toujours des fonctions officielles.
« Peut-être que les militaires n’ont pas peur des sanctions, s’interroge Aissatou, violée au stade le 28 septembre 2009. Ils sont libres de faire ce qu’ils veulent. »
Extrait: memoire-collective-guinee.org