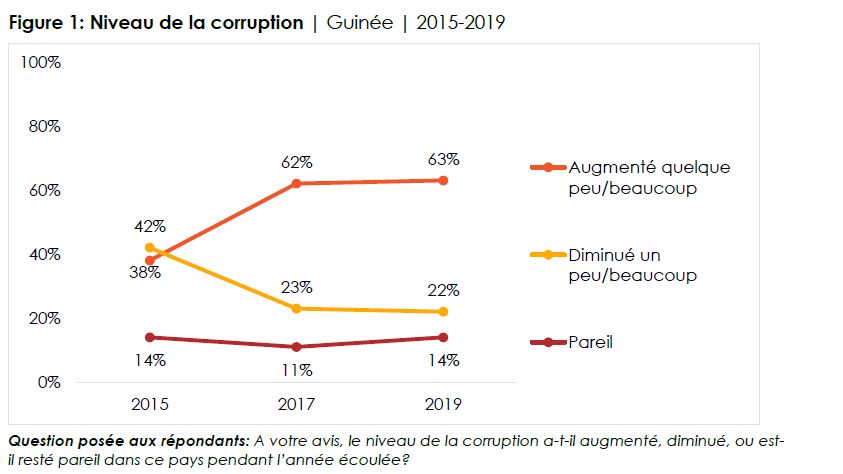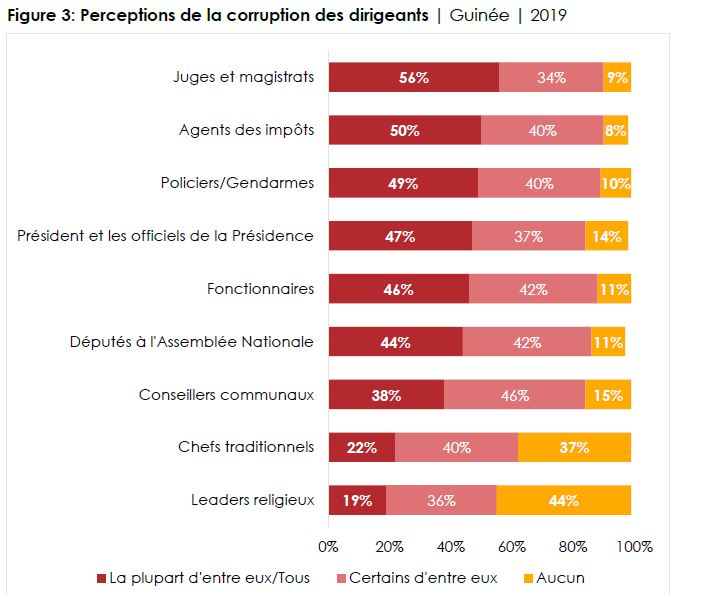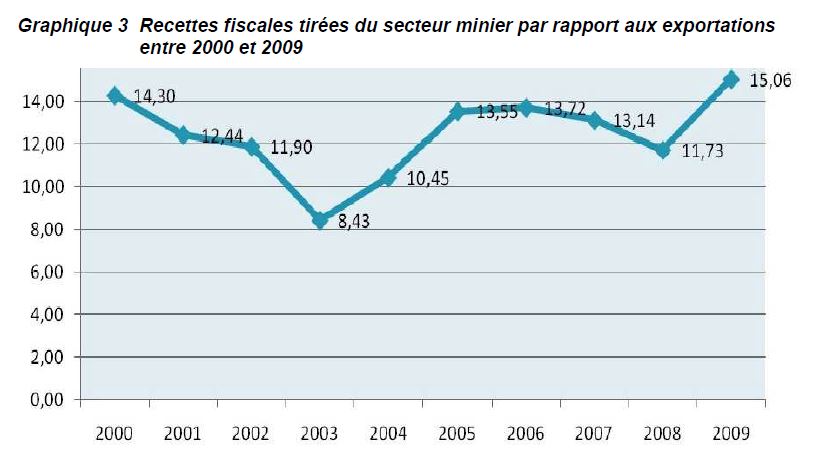Quel régime pour la Guinée?

Point de vue
Par Pr. Alpha Amadou Bano BARRY (PhD, sociologie)
Au regard de l’histoire politique guinéenne marquée par le même type de régime politique et trois transitions, cet essai se propose de dévoiler les constantes du système politique qui sont au nombre de deux : la primauté du président sur toutes les institutions et celle des partis politiques sur le jeu politique avec le monopole de la candidature aux élections nationales et un système électoral dont les deux tiers des députés sont élus au travers d’une liste nationale. Ce texte a cherché aussi à déconstruire le fondement de la question ethnique en Guinée, sujet récurrent dans les échanges des salons et des bureaux, mais rarement en public. La question ethnique en Guinée est essentiellement politique et sert aux élites à assurer le contrôle de l’État et de ses ressources. Un président fort est le point central du dispositif du contrôle ethnique. Au regard de cette réalité, la Guinée gagnerait à expérimenter un autre système, celui du ticket aux élections présidentielles et d’un système électoral majoritaire à un tour et une forte décentralisation pour rendre le peuple plus responsable de son destin.
Cet essai est mon second sur la question du régime politique en Guinée. Le premier a été publié après 2010 et n’a servi, ni à doter le pays d’une constitution adaptée aux réalités sociologiques de Guinée, ni à éviter une troisième prise du pouvoir par les armes.
En 2023, je refais le même exercice tout en étant conscient que les intérêts sont si antagoniques dans ce pays qu’il est difficile d’arriver à soutenir ce qui ne favorise pas certains groupes. D’autres aussi n’aimeront tout simplement pas cette réflexion qui vient d’un ancien ministre[1] du régime précédent, car il a toujours été un crime de servir son pays en Guinée. Enfin, je sais aussi que les leaders politiques les plus représentatifs dans le paysage politique guinéen ne vont pas aimer. Car tous veulent un régime présidentialiste comme celui en vigueur depuis 1958 dans l’espoir qu’ils en seront les bénéficiaires. N’étant pas constitutionnaliste ni juriste, mon regard ne porte pas sur les règles du droit, mais sur leurs effets attendus ou imprévus sur le système politique et sur la société. Le regard du sociologue glisse en quelque sorte sur le droit, pour « obliquer» vers les contextes sociaux, économiques, politiques, culturels dans lesquels il prend naissance.
Au centre de la préoccupation du sociologue, c’est « l’esprit de la loi », c’est-à-dire ce qui serait le mieux en fonction des réalités sociologiques des populations et de ses élites à un moment donné de son histoire, la prise en compte de la réaction du milieu à la règle du droit avec un focus sur les acteurs et le processus de rédaction et d’adoption d’une constitution.
Durant le symposium organisé par le Conseil National de la Transition (CNT), j’ai eu le privilège d’écouter des sommités sur l’ensemble des composantes du système politique, de l’administration et de l’État. Il m’a été donné d’entendre par certains que la constitution des USA est la plus stable, car elle est dans les principes, la philosophie et laisse à la cour suprême le soin de trancher sur chaque cas qui pose un problème d’interprétation. Mais il est certain que le second amendement de la constitution américaine n’aurait pas été si ce pays n’a pas utilisé les armes pour conquérir son territoire, ni avoir des esclaves qu’il fallait dominer ni une guerre civile. Dans chaque constitution, l’histoire politique et les réalités sociologiques s’incrustent.
D’autres ont insisté pour faire valoir que le meilleur texte constitutionnel ne résoudra pas les problèmes d’éthique, de compétences et de courage des hommes et des femmes en charge d’appliquer et de faire appliquer le droit. On peut néanmoins ajouter que cela n’empêche pas d’avoir des « bons textes », c’est-à-dire des textes qui pourraient prendre en charge les réalités sociologiques et aider à corriger les lacunes. Car même si presque tous les conducteurs de mototaxis de Conakry ne respectent pas les feux de signalisation, personne ne se risquera à recommander qu’on élimine pour autant ces feux ou de ne pas prévoir des sanctions dans le code de la route.
La règle de droit est un discours normatif qui dit ce qui doit être, ce qu’il faut faire ou ne pas faire, et parfois comment le faire, et prévoit la sanction positive ou négative des actions permises, imposées ou prohibées.
Comme norme, la loi ne valide pas seulement une pratique en cours, elle peut aussi vouloir corriger une norme car elle possède une capacité de coercition pour amener la conduite individuelle vers ce qui est prescrit. C’est dans cette logique qu’il faut inscrire la loi sur la polygamie, l’excision et beaucoup d’autres dispositions de normes sociales. Donc, une bonne règle de droit a aussi pour vocation d’imposer une norme juridique pour qu’elle devienne une norme sociale.
Certes, la meilleure constitution n’éliminera pas les « faux démocrates », mais une « bonne loi démocratique » permettra d’avoir des leviers sur lesquels compter pour lutter et protéger les règles démocratiques. Le meilleur exemple de texte de lois ayant changé radicalement les choses est le travail fait par Jerry Rawlings au Ghana avec un système politique qui a permis d’asseoir une alternance démocratique. Ma lecture du marxisme et ma compréhension de la réalité sociale me font admettre que les hommes ne sont pas « bons » ni « mauvais » de façon génétique, ils sont simplement le produit de leur milieu. Si le milieu change, l’environnement impose de nouvelles normes, les Hommes s’ajustent et s’adaptent.
Le défi de la Guinée est, dans cette transition, d’avoir « des textes adaptés à nos réalités ». C’est-à-dire des textes qui corrigent les effets des différentes constitutions sur la société guinéenne. Car certaines des dérives actuelles dans la vie politique ne proviennent pas seulement du « mauvais Guinéen » non courageux, mais des textes comme je vais le montrer dans l’analyse sociologique des constitutions de 1958 à 2020.
LES EFFETS DE CERTAINES DISPOSITIONS DES CONSTITUTIONS DE 1958 A 2020
La Guinée, depuis sa première constitution de 1958, s’est inscrite dans un régime avec une forte primauté du Président de la République sur les autres pouvoirs et institutions de la République.
C’est la première constitution du 10 novembre 1958 qui a conféré au président de la République, en son article 25, l’autorité de nommer « […] à tous les emplois de l’administration publique. Il nomme à tous les emplois et fonctions militaires ». Cette disposition est restée intangible dans toutes les constitutions même si en 2010, un effort non abouti a été tenté pour donner un peu de pouvoir au premier des ministres avec deux articles contradictoires dont l’article 46 qui dit que le président : « nomme en conseil des Ministres aux emplois civils dont la liste est fixée par une loi organique » et l’article 58 qui dispose que : « Le Premier Ministre dispose de l’administration et nomme à tous les emplois civils, excepté ceux réservés au chef de l’État ».
Il était prévu que l’Assemblée Nationale, qui sortirait des urnes à la fin de la transition, devrait se charger de l’élaboration et de l’adoption de cette loi organique. Pendant les 11 ans, cette loi organique n’a jamais vu le jour et les nominations n’ont jamais été faites en Conseil des Ministres.
C’est la constitution de 1982 qui met au-dessus de l’édifice institutionnel le parti unique, le Parti Démocratique de Guinée (PDG) sur l’État et les institutions de la République avec la formule suivante :
a) Que la Nation Guinéenne est née de l’État ;
b) Qu’elle est engendrée par l’action des masses populaires mobilisées au sein du Parti Démocratique de Guinée ;
c) Que c’est le Parti qui a fondé l’État et que cet État ne peut donc que s’identifier au Parti qui l’organise, le dirige et le contrôle, en assumant réellement toutes les fonctions en tant que Parti-État et en œuvrant à la réalisation du Peuple-État.
Les constitutions de 1990 et les suivantes (2010 et 2020) ont aussi gardé les dispositions de l’article 25 de 1958 qui garantit la prépondérance du Président de la République dans l’agencement des pouvoirs, mais celle de 90 dans son article 3 (dans sa première version et dans sa version révisée de 2001) et celle de 2010 ont renforcé de leur côté la puissance des partis politiques en réservant aux seuls partis politiques, le droit de présenter « les candidats aux élections nationales », avec unsystème électoral qui fait élire les deux tiers des députés (76 sur les 114 députés) à la proportionnelle et seulement 38 à l’uninominal.
Les conséquences de l’article 25 et de la suprématie du parti unique ont fait du Président de la République un homme qui règne comme un monarque et qui gouverne seul et parfois avec des hommes de l’ombre qui deviennent plus puissants que ceux en position institutionnelle. Cette prépondérance absolue du président de la République a contribué à affaiblir pratiquement toutes les autres institutions ou à les inféoder à une personne oubliant les remarques de Montesquieu qui disait que : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser […] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».
Le droit accordé aux seuls partis politiques dans la désignation des candidats aux élections nationales (législatives et présidentielles) dans la constitution de 90 et le système électoral qui fait que les deux tiers des députés sont élus sous la bannière des partis politiques sur une liste nationale expliquent la toute-puissance des leaders des partis politiques et la subordination des élites administratives, commerciales et coutumières aux leaders politiques. Car ce sont les leaders des partis politiques qui déterminent les chances des uns et des autres à devenir député par leur positionnement sur la liste à la proportionnelle.
Élu sous la bannière d’une liste nationale d’un parti politique, sans aucun contact avec le peuple et avec la bénédiction des premiers responsables des partis politiques, les députés de la liste nationale n’ont aucune redevabilité envers la population, parce que n’étant pas élus directement par elle. C’est cette disposition qui explique la prolifération des partis politiques (186 semble-t-il). N’ayant pas d’ancrage local, ceux qui veulent devenir député et qui ne peuvent l’obtenir à partir d’un parti établi sont donc dans l’obligation de créer un parti et se présenter sur la liste nationale dans l’espoir de bénéficier du plus fort reste. Ce n’est pas le laxisme des fonctionnaires du ministère de l’administration du territoire dans la création et le contrôle de la fonctionnalité des partis politiques qui explique la prolifération des partis politiques. Ce sont les dispositions des constitutions guinéennes qui expliquent la prolifération des partis politiques et la tribalisation du jeu politique.
Pour corriger ces créations exponentielles des partis politiques, des solutions existent à travers les règles des systèmes électoraux[2] comme le font les pays anglophones et en particulier ce que Jerry Rawlings a fait pour le Ghana[3]. C’est donc en corrigeant ces dispositions institutionnelles dans la future constitution qu’il sera possible de solutionner certains dysfonctionnements actuels. C’est ce dispositif qui est exposé ci-dessous.
COMMENT RATIONNALISER LE NOMBRE DE PARTIS POLITIQUES DANS UN PAYS ?
Cette question sur le nombre de partis politiques en Guinée est dans le débat depuis 1990 avec la proposition du Président Lansana Conté de légaliser 2 partis politiques. Ce débat est redevenu actuel, polluant même la réflexion, après le retour de mission du Conseil National de la Transition (CNT) de l’intérieur du pays avec la demande de la population de réduire le nombre de partis politiques.
Le 5 septembre 2021, suite au changement de régime, avec la dissolution du gouvernement et de l’assemblée nationale, il aurait été plus compréhensible d’accompagner ces mesures par la dissolution des partis politiques, des syndicats et des organisations de la société civile au nom de la « refondation ».
En ne le faisant pas à ce moment, il est devenu problématique de proposer dans la nouvelle constitution un système direct de réduction des partis politiques à 2 ou à 3. En 2023, plus de 15 mois après le changement de régime, toute tentative dans ce sens risque de ne pas bénéficier de consensus et pourrait soulever des revendications. D’autant que les plus farouches partisans de cette dissolution des partis politiques sont des leaders politiques qui ne pèsent presque rien sur l’échiquier politique. L’un pourrait justifier l’autre. De par l’expérience universelle, deux procédés existent pour réduire le nombre de partis politiques dans un pays. Il y a la formule directe et celle indirecte. Dans l’article de Jean Laponce (1962) ; « Bipartisme de droit et bipartisme de fait », Revue française de sciences politique, Paris, France, pp. 877-887, il est clairement mentionné que la restriction directe du nombre de parti politique est « d’établir par la loi le nombre des partis politiques autorisés à présenter des candidats aux élections ou bien encore de définir le nombre des partis autorisés à envoyer des représentants au Parlement ». Cet auteur met en évidence que « la limitation du nombre de parti n’est pas en contradiction avec les règles du jeu démocratique »,
De façon indirecte, il est possible d’y arriver aussi par des mesures législatives comme de restreindre le « droit de présenter des candidats aux deux seuls partis ayant obtenu le plus de voix à une élection primaire dans le cadre national ». De même, « la loi peut chercher à agir directement sur le nombre des partis en interdisant la représentation aux partis n’ayant pas obtenu un minimum de voix ». Dans ces conditions, « plus le minimum légal est élevé, plus grande est la pression sur les partis existants pour qu’ils se groupent » et donc se réduisent.
On peut aussi agir en changeant le système électoral. On sait que le scrutin majoritaire contribue fortement à une bipolarisation de l’expression du suffrage politique. Souvent pour obtenir une application stricte du bipartisme, d’autres dispositions complémentaires sont édictées sur les structures internes des partis, en imposant par exemple, comme c’est le cas aux Etats-Unis dans la majorité des États, l’élection des dirigeants du parti par l’ensemble non pas des membres du corps électoral mais seulement des électeurs du parti.
Le Ghana est, en Afrique, l’exemple typique d’un système indirect. Bien qu’ayant seize partis officiellement enregistrés, c’est deux partis politiques (National Democratic Congress, « NDC » et le National People’s Party « NPP ») qui s’alternent au pouvoir.
Le système électoral dans ce pays est fait de sorte qu’il apparaît difficile aux autres partis de remporter une élection. Au Ghana, les 230 membres du parlement du Ghana représentent les 230 circonscriptions du pays. Comme pour l’élection présidentielle, ils sont élus au suffrage majoritaire uninominal. C’est ce modèle qui donne le résultat de cette alternance démocratique tant vantée par les Guinéens.
Avec ce système indirect, le Ghana confirme la théorie de Maurice Duverger[4] qui démontre que le système électoral majoritaire à un tour est de nature à favoriser l’émergence d’un système bipartite. Donc la mesure la plus simple et la moins sujette à discussions pour réduire le nombre de partis politiques est la mise en place d’un système indirect au travers de l’utilisation du système électoral majoritaire à un tour.
Pour mettre en place ce dispositif, on devrait supprimer l’élection à la proportionnelle sur la liste nationale pour n’avoir que des députés élus dans une circonscription électorale et procéder au découpage du territoire national en circonscription électorale en tenant compte de certaines contraintes :
- Les préfectures qui ne remplissent pas le nombre d’électeurs requis pour atteindre le quorum doivent néanmoins se faire représenter à l’assemblée par un député élu à l’uninominal ;
- Dans les préfectures du pays qui dépassent ce quorum et ne font pas le double ou le triple ou quadruple, on procède toujours à l’arrondissement par le haut pour déterminer le nombre de députés qui sont tous élus à l’uninominal ;
- Les Guinéens de l’étranger devront être représentés par des députés élus dans des circonscriptions électorales. Ces circonscriptions peuvent regrouper plusieurs pays mis ensemble si le nombre d’électeurs n’atteint pas le quorum ou d’un seul pays si le nombre d’électeurs est conforme au quorum fixé.
D’ailleurs, personne ne devrait se soucier du nombre et de la gouvernance interne des partis politiques si l’article 3 disparaît. Sans cette disposition, chaque Guinéen qui remplit les conditions d’éligibilité devrait avoir la latitude de se présenter à toutes les élections nationales et locales. Dès que cette disposition sera adoptée, les partis politiques vont se vider de ceux qui y sont pour devenir député ou maire et se rempliront plus tard sur la base de la proximité idéologique.
La question de la tribalisation du débat politique en Guinée vient aussi du système politique avec un président élu seul à la tête d’un parti politique au suffrage universel à deux tours s’il n’a pas la majorité absolue au premier tour. C’est pour cette raison que je vais me permettre de dire quelques mots sur la question ethnique pour la déconstruire, car l’existence des ethnies ne signifie pas que les Guinéens sont des « ethnos ».
LA QUESTION ETHNIQUE EN GUINÉE
Les ethnies existent en Guinée et existeront pour toujours. Certains groupes ethniques actuels, ou qui se considèrent comme tels, n’existaient pas il y a de cela quelques siècles auparavant. D’autres groupes ethniques se sont détachés par la migration et se sont différenciés dans le temps avec des groupes qui les englobaient hier. D’autres enfin qui existaient jadis ont été absorbés au cours des siècles à travers les migrations, les cohabitations, les brassages et les assimilations.
Parmi ceux qui existent, certains vont disparaître, d’autres vont s’agrandir, d’autres enfin garderont l’étiquette et perdront certains de leurs attributs. Bref, les ethnies sont comme un corps : elles naissent, se développent, meurt et renaissent pour certaines et disparaissent pour toujours pour d’autres.
Tous les spécialistes de l’installation des populations que le colon a désigné par « Guinée », s’accordent à reconnaitre que les populations de la Guinée sont originaires du Sahel, à l’exception notable des Mandeyi et des Lomas, et que ces populations sont arrivées sur le territoire guinéen par vagues successives au cours des siècles. Certains des membres de ces groupes ne sont même pas venus ensemble comme les Bagas, les Nalous et les Peuls.
Les groupes ethniques en Guinée (que l’on dénombre à 24) donnent l’illusion à leurs membres d’avoir une origine lointaine commune, un destin identique et des valeurs meilleures que celles des autres. C’est ce sentiment développé et véhiculé qui consolide l’unité du groupe et renforce la solidarité. Pourtant, il n’est pas rare de constater dans la même ethnie, la pratique de plusieurs religions et des variations du phénotype et des ressemblances entre des individus appartenant à des ethnies différentes.
Chaque groupe fait croire, par la socialisation de ses membres, que sa culture, la manière d’être et de vivre sont les seules valeurs respectables. Dans la réalité, les différences affichées et parfois revendiquées ne sont que variations d’adaptation.
Les Guinéens ont une longue histoire commune, une histoire antérieure à celle de l’État guinéen et même à la colonisation. On sait avec certitude que le dessèchement du Sahara et la chute de l’empire du Ghana (vers 1076) ont eu pour conséquence une très grande mobilité des populations africaines de l’Ouest.
Cette mobilité s’est poursuivie et s’est prolongée avec la naissance et la disparition de tous les empires et États de la région (Mali au 13ème siècle, Songhaï au 15ème siècle, Ségou au 17ème siècle, Foutah Djalon et Macina au 19ème siècle, etc.) qui se sont succédé sur ce vaste espace qui va du désert à la lisière de la forêt en passant par la savane et les zones montagneuses du Foutah Djalon.
Cette histoire commune a façonné des liens (parenté à plaisanterie, liens matrimoniaux et autres liens de solidarité) qui soudent la société guinéenne et lui permet d’affronter les vicissitudes du « vivre ensemble ». Les ethnies qui habitent la Guinée sont semblables sur l’essentiel. Le mariage est le lieu privilégié de procréation, le système dominant est le patriarcat et la gérontocratie et la solidarité sont valorisées. Bref, les ethnies ont, pour l’essentiel, les mêmes valeurs. Les différences sont surtout linguistiques et organisationnelles, résultats des particularités historiques, démographiques et d’adaptation à l’environnement de vie. Même linguistiquement, ces 24 groupes ethniques se regroupent en deux familles de langues[5] pour parler comme les linguistes :
- Le groupe mandé qui regroupe le maninka, le Koniaka, le sosoxui, le dialonka, le lomagi, le kpèlèwoo etc. et ;
- Le groupe atlantique qui regroupe le tanda, le pular, le toucouleur, le kisiéi, le baga, le nalou et même d’autres langues de pays voisins comme le ouolof, le sérère, le diola au Sénégal et le balante en Guinée-Bissau.
Les Guinéens n’ont aucun problème à vivre ensemble, au sein du même quartier, dans la même cour, se marier entre eux, sans aucune considération autre que les sentiments des prétendants et le revenu de l’un ou de l’autre. Certes, les hommes de certaines communautés ont plus de difficulté que d’autres à contracter des liens matrimoniaux dans toutes les communautés et surtout dans toutes les familles.
Dans la vie de tous les jours, la différence ethnique est moins importante que celle en lien avec les classes sociales (pauvres et riches) et aux stratifications sociales (castes et autres catégories stigmatisées).
Ce n’est pas pour rien qu’en dépit des tensions orchestrées par certains acteurs politiques au moment des seconds tours des élections présidentielles, la Guinée n’a jamais basculé dans la guerre civile, ni dans la tentation de la sécession régionaliste. C’est d’ailleurs l’une des particularités de la Guinée : pays fragile sans mouvement sécessionniste.
Ce que tous les Guinéens ont voulu et veulent, en dépit de la suspicion, de la méfiance et de l’instrumentalisation ethnique, c’est d’être des Guinéens avec des droits identiques, des possibilités réelles de s’épanouir, de se réaliser et de pouvoir bénéficier des mêmes droits dans le choix des dirigeants du pays, d’accéder à la présidence de la République, aux hautes fonctions de l’administration publique et aux marchés publics sans aucune discrimination.
On peut dire, et ma spécialité et ma connaissance de la Guinée me le permettent, le problème de l’ethnicité en Guinée porte essentiellement sur l’accès aux ressources de l’État, aux avantages qu’ils procurent, aux privilèges qui s’y rattachent, à savoir :
- La présidence de la République et les accessoires que ce régime présidentiel offre, car il est sans contrôle ; les postes de l’administration publique (le président de la République nomme et révoque du plus grand au plus petit fonctionnaire) ;
- Les marchés publics (le président de la République attribue, à sa guise, richesses et pauvreté à qui il veut, comme Dieu) ;
- Les services sociaux comme les évacuations sanitaires aux frais de l’État et les bourses d’études à l’étranger logées à la présidence de la République.
On peut donc dire que l’ethnicité au niveau des élites administratives, politiques et commerciales est une stratégie individuelle qui permet d’accéder aux ressources de l’État. C’est une stratégie identique qui a été utilisée par certains jeunes après le 5 septembre pour éliminer toute concurrence en obtenant du nouveau chef de l’État qu’il dise qu’il n’y a pas « une école d’expérience » et « pas de recyclage ». L’ethnie, la jeunesse, les femmes, les handicapés ne sont rien d’autres que des variables que certains activent pour éliminer la concurrence, en vendant une catégorie « naturelles » en lieu et place d’une compétence.
Cette stratégie peut devenir collective en raison du fait que celui qui contrôle le pouvoir suprême récompense les membres de son « groupe ethnique » pour service rendu, l’appui à accéder à la présidence.
Contrairement à une idée largement répandue, tous les partis politiques guinéens ne sont pas « ethniques », certains qui ont recours à l’ethnicité le font à leur corps défendant. Rares sont aussi les partis politiques qui ne jouent pas de la corde ethnique à un moment ou à un autre, en des circonstances particulières et en présence de certains enjeux.
Si les partis se servent du fait ethnique ou sont facilement identifiables à des groupes ethniques, c’est parce qu’en dépit de l’existence de la réalité ethnique, les règles juridiques de la Guinée soumettent les candidats à la présidence, surtout au second tour, à l’instrumentalisation de l’ethnie pour gagner l’élection.
Depuis notre indépendance, nous mimons d’autres pays comme si nous avions une même histoire, un même processus de construction étatique et les mêmes populations avec la même sociologie.Le fait de demander que la nouvelle constitution tienne compte de la dimension sociologique ne signifie pas que les Guinéens doivent avoir une « constitution ethnique » comme au Liban ou le Burundi avec un partage ethnique du pouvoir. Cela ne veut pas dire que tous les Guinéens sont des « ethnos », ni plus, ni moins que d’autres Africains dans la sous-région. Il s’agit simplement d’avoir une constitution qui renvoie l’ethnie dans la sphère privée et domestique. C’est ma proposition exposée ci-dessous.
QUELLE CONSTITUTION POUR LA GUINÉE
La configuration ethnique de la Guinée et le passé politique devraient amener le législateur « pouvoir constituant dérivé » à proposer une constitution qui brouille le repérage ethnique en choisissant un régime politique de type présidentiel avec un ticket (président et vice-président), sans un premier Ministre, comme dans le modèle des Etats-Unis ou du Nigéria.
Ce modèle est celui du Nigéria après la guerre de sécession, du Kenya après les violences ethniques post-électorales, de l’Afghanistan après la longue guerre civile, de la Sierra Leone et de la Côte d’Ivoire après les sanglantes guerres civiles dans ces deux pays.
Les critiques « juridiques » peuvent faire valoir que le vice-président dans le modèle américain est un président en réserve « un corps sans vie » jusqu’à l’empêchement de « l’autre », le président en exercice à la suite duquel il achève le mandat.
Dans la sociologie électorale de la Guinée, l’objectif n’est pas d’avoir un président « bis », mais plutôt d’avoir quelqu’un avec lequel on fait la campagne électorale pour éviter la « tribalisation » du débat électoral. Celui qui va aider son colistier à ne pas nommer seulement les membres de sa communauté, à ne pas tribaliser l’administration.
Dans une configuration institutionnelle pareille (président et vice-président), il serait suicidaire politiquement pour chaque candidat de choisir son colistier au sein de sa communauté. Quel que soit le nombre de candidats, on aura une configuration des tickets avec des combinaisons « mathématiques » de la Guinée dans sa diversité la plus large.
Dans ces conditions, il sera impossible de coller des étiquettes ethniques aux candidats en compétition. Et en même temps, on réduit la capacité des manipulateurs de la « chose ethnique », à trouver la faille à partir de laquelle ils pourraient l’instrumentaliser. En fait, ce type de régime aurait pour mérite de brouiller les logiques ethniques qui se rattachent à la candidature singulière d’un homme qui demande le suffrage du peuple.
Dans ce type de régime politique proposé et, pour permettre à l’équipe présidentielle d’avoir un bilan avant la fin de son mandat, il serait souhaitable d’avoir un mandat de 7 ans non renouvelable[6]. Un mandat de 7 ans devrait permettre à l’exécutif de faire un état des lieux des différents ministères, de monter des projets et des programmes, de mobiliser les ressources et de conduire les actions jusqu’au bout du mandat sans se soucier de l’élection à venir. Si la performance de ce mandat est probante, il serait possible que ce ticket dans sa combinaison actuelle ou dans une autre formule de se représenter après le mandat de ses successeurs afin de faire mieux lors du second mandat qui n’est possible que 7 ans après. Cette disposition a un double avantage à savoir :
- Ce mandat unique prédispose l’équipe présidentielle élue à se concentrer exclusivement sur son mandat et à la mise en œuvre de son programme (état des lieux, élaboration des projets, mobilisation des ressources et mise en œuvre, suivi et évaluation) et donner à voir les résultats avant de quitter le pouvoir ;
- Ce mandat unique empêche l’utilisation des ressources publiques par l’équipe sortante dans le cadre d’une nouvelle campagne électorale.
Si les Guinéens souhaitent deux mandats, il est préférable d’avoir deux mandats de 7 ans que deux mandats de 5 ans. Car dans un mandat de 5 ans, compte tenu du temps nécessaire pour des ministres de comprendre les rouages de l’administration publique, de faire un état des lieux objectif, de proposer une vision, de mobiliser des ressources[7], un gouvernement perd au minimum 18 mois avant de commencer de mettre en œuvre son programme. Dès la 4ème année, le président et son équipe retournent en campagne pour une année. S’il est reconduit, le processus recommence. De sorte que sur 10 ans, un président ne peut travailler réellement que 5 ans. Par contre, dans un mandat de 7 ans renouvelable, le président peut avoir 12 ans pour mettre en œuvre ses projets et programmes.
Une élection présidentielle et législative chaque 7 ans aurait l’avantage d’utiliser le budget national et l’appui budgétaire des partenaires techniques et financiers à autre chose qu’à financer des élections. Selon le rédacteur en chef[8] du Lynx, les élections législatives et présidentielles entre 2015 et 2020 ont « englouti pas moins de 1 695 milliards de francs guinéens soit près de 139 millions d’Euros. Un budget qui vaut plus du tiers du montant pour la réalisation de la route Mamou-Dabola qui est en chantier. Car le coût de ce projet est de 357 millions 302 942 mille Euros pour 370 Km ».
Dans ce régime, il serait souhaitable de canaliser l’équipe présidentielle dans l’exercice de son mandat, car « tout homme qui a du pouvoir est tenté d’en abuser. Seul le pouvoir arrête le pouvoir », en indiquant dans la constitution le nombre maximum des membres du gouvernement, de conseillers à la présidence et en limitant les postes à nomination qui relèvent de l’autorité du président (les ministres, les ambassadeurs et les chefs militaires).
Les ministres et les ambassadeurs proposés par le Président de la République devraient se soumettre à l’obligation d’audition devant les députés pour décliner leur feuille de route et permettre aux députés de produire une fiche évaluative à l’attention du Président de la République sur leur capacité à présenter et à défendre leurs dossiers et leur vision du secteur avant la signature de leur décret. Le président n’est pas obligé de modifier sa décision de nomination, mais il a une évaluation objective sur le personnel le plus élevé de sa gouvernance.
Les ministres devraient bénéficier de l’autorité nécessaire pour désigner les membres de leur cabinet (chef de cabinet, conseillers et attaché de cabinet) et les directeurs nationaux y compris ceux du pool financier, des ressources humaines et de la passation des marchés[9]. De même, chaque directeur devrait avoir l’autorité de proposer les chefs de division de sa direction et les chefs de section devraient être proposés par chaque chef de division.
Ce régime présidentiel doit l’être dans toute sa plénitude avec une séparation nette et étanche entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Il faut trouver les mécanismes et des modalités visant à garantir l’indépendance et l’intégrité du judiciaire en réduisant de façon drastique l’instrumentalisation des cours et des tribunaux par l’exécutif.
Il existe aussi dans l’air du temps l’idée d’avoir deux chambres (Haute et Basse), personnellement, je suggère une véritable décentralisation comme le dit si bien Bérété[10] dans sa thèse de doctorat en proposant que « Ces réformes devraient consacrer la séparation réelle des pouvoirs et la clarification des compétences entre l’Etat et les structures administratives en milieu local. Elles devraient ensuite impliquer l’augmentation des échelons territoriaux, le transfert progressif des compétences et des ressources et la définition du rôle des nouveaux acteurs du développement à la base : les Organisations de la Société Civile »[11]. Il a été transféré à des collectivités de base, les communes, des compétences qu’il aurait fallu donner à la région et à la préfecture. Car elles sont mieux outillées pour assurer ce transfert de compétences que les communes en l’état actuel. Au niveau des partis politiques qui arrivent à avoir des députés à l’assemblée nationale, il serait souhaitable de prévoir une subvention de 5% pour les financer afin d’éviter le financement du président fondateur. Naturellement, ce financement devrait avoir comme conséquence le non-financement d’un parti par un leader et toute autre personne, entité et/ou société avec obligation d’assurer le contrôle des dépenses des partis politiques par la Cour des Comptes, comme n’importe quelle entité qui reçoit des finances publiques. Si les dons et legs sont acceptés, ceux-ci devraient passer par le bureau de l’assemblée nationale pour assurer leur traçabilité.
Dans ce cas de figure, on devrait prévoir et codifier une procédure démocratique interne à chaque parti politique. Un cadre organique devrait indiquer certaines modalités de gestion de chaque parti politique avec l’obligation d’avoir une carte du parti et de payer ses cotisations annuelles pour être électeur et éligible au sein du parti. Les élections internes devraient être régulières et précéder les consultations nationales. Ces élections devraient se faire par l’organisme national en charge des élections du pays qui doit être à l’image de celle du Ghana avec des commissaires techniques qui ont la sécurité de mandat : « ils sont nommés à vie et ne peuvent pas être relevés brutalement de leur fonction par le Président de la République ». Dans ce système,aucun des élus ne devrait pouvoir changer d’étiquette politique en quittant son parti pour rejoindre un autre parti en cours de mandat ou créer un groupe politique.
En termes clairs, cette transition pour réussir doit rompre avec la trajectoire des précédentes pour que la démocratie ne soit ni communautaire, ni un moyen de créer et d’entretenir des dirigeants autoritaires, ni d’aider à avoir des politiciens de « chambre » d’accéder au pouvoir par le jeu de la transhumance et des allégeances de circonstances. De même, on ne devrait pas refaire les erreurs de 2010 en créant plusieurs organes[12] budgétivores pour caser le plus grand nombre de personnes.
On se doit de tirer les leçons des décisions sociologiquement erronées des deux premières transitions (1984 et 2009), pour éviter d’être schizophrénique, car “la folie, c’est se comporter de la même manière et s’attendre à un résultat différent” (Albert EINSTEIN).
CONCLUSION
Au terme de cet exposé, il me plait de dire en quelques mots les grandes lignes de ma réflexion sous la forme de propositions non noyées dans des considérations théoriques et académiques dans l’espoir que quelques-unes au moins trouveront une oreille attentive auprès des Guinéens.
- Considérant que le régime politique guinéen a toujours été un régime marqué par une forte primauté du Président de la République sur les autres pouvoirs et institutions de la République avec un pouvoir de nomination à tous les emplois militaires et civils, y compris ceux qui pourraient relever des ministres sectoriels ;
- Constatant l’instrumentalisation ethnique et régionaliste lors du second tour des élections présidentielles ;
- Soucieux de doter le pays d’un système politique qui corrige les erreurs du pays ;
- Proposons un régime politique de type présidentiel avec un ticket (président et vice-président), sans un Premier Ministre, pour brouiller les logiques ethniques qui se rattachent à la candidature singulière d’un homme qui demande le suffrage du peuple ;
- Suggérons que la durée du mandat présidentiel soit de 7 ans non renouvelable ;
- Proposons qu’il soit prévu que le Vice-Président achève le mandat du Président en cas de vacance du pouvoir ;
- Insistons pour que le nombre de ministres dans un gouvernement, de conseillers à la présidence et dans les cabinets ministériels soit déterminé dans une loi organique à adopter avant la constitution ;
- Plaidons pour que les futurs ministres soient auditionnés par les députés, avant leur nomination, afin qu’il soit établi par les députés à l’attention du Président de la République une fiche d’avis technique ;
- Demandons que le Président ne nome que les ministres, les conseillers à la présidence, les ambassadeurs et les chefs militaires ;
- Suggérons que les ministres bénéficient de l’autorité nécessaire pour désigner les membres de leur cabinet (chef de cabinet, conseillers et attaché de cabinet) et les directeurs nationaux techniques et le pool financier, les ressources humaines et la passation des marchés. De même, chaque directeur devrait avoir l’autorité de proposer les chefs de division de sa direction et les chefs de section devraient être proposés par chaque chef de division ;
- Exigeons la possibilité de candidatures indépendantes à toutes les élections (présidentielle, législative et locales) ;
- Demandons la refonte totale du code électoral pour l’adapter au mode électoral majoritaire et en supprimant en particulier plusieurs dispositions qui facilitent la fraude électorale du bureau de vote à l’organe de gestion des élections ;
- Proposons un Organe de gestion des élections (OGE) technique avec des membres qui ont la sécurité de mandat comme au Ghana : « ils sont nommés à vie et ne peuvent pas être relevés brutalement de leur fonction par le Président de la République ». On peut même y ajouter d’autres éléments de sécurité supplémentaire.

NOTES
[1]En Guinée, on ne devient coupable que lorsqu’on a été ministre. Tous les autres, ceux au-bas de l’échelle administrative, ne sont coupables de rien.
[2]Le système électoral d’un État comprend l’ensemble des règles, normes et institutions régissant la préparation, l’organisation et la conduite des élections. Il peut difficilement être analysé en dehors du cadre institutionnel du régime politique en vigueur.
[3]Le Ghana a connu sa première alternance lors des élections présidentielles de 2000 qui vit la défaite de Jerry Rawlings en faveur de John Kufuor.
[4]Duverger, M (1976) ; « Les partis politiques » ; Armand Colin, Paris, France.
[5]Contrairement à ce que beaucoup « d’analphabètes » diplômés disent, une famille linguistique n’est pas une parenté ethnique ni une appartenance au même groupe ethnique.
[6]Dans tous les cas, on se souviendra que dans un mandat de 5 ans, la pré-campagne et de la post-campagne absorbent 2 ans et ont des effets réels sur la création et la gestion des ressources nationales.
[7]Si le financement vient des partenaires techniques et financiers et non d’un prêt que la FMI refuse au nom du principe du taux d’endettement admise pour ces gendarmes des pays pauvres, il faut compter 2 ans avant de voir la couleur de l’argent. Car avec ces partenaires, le processus est plus important que le résultat.
[8]Mamadou Siré Diallo.
[9]L’ancien président avait déjà acté la nomination du responsable de passation des marchés par chaque ministre de tutelle. Il faut aller plus loin en éliminant le fait que les ministres sectoriels (finances, budget et fonction publique) nomment du personnel au sein des autres ministères. Sur d’autres publications, je vais revenir plus en détail sur cette nécessité.
[10]Mohamed Bérété (2007) ; « La décentralisation et le problème de la monopolisation du pouvoir par l’appareil d’Etat en République de Guinée », Thèse de Doctorat, Université Robert Schuman, Strasbourg, France.
[11]Rares sont les cadres du ministère de l’administration du territoire qui ont lu ladite thèse et il aurait plus utile dans ce ministère qu’à la santé.
[12]11 ans plus tard, certains de ses organes (Haute Cour de la justice, Haut conseil des collectivités) n’ont pas vu le jour.