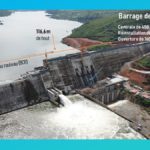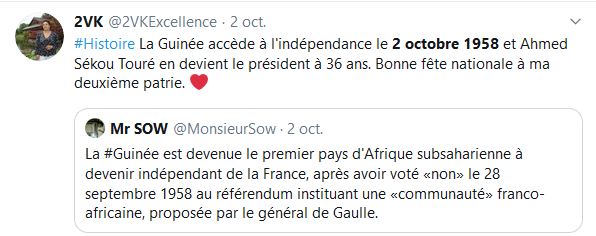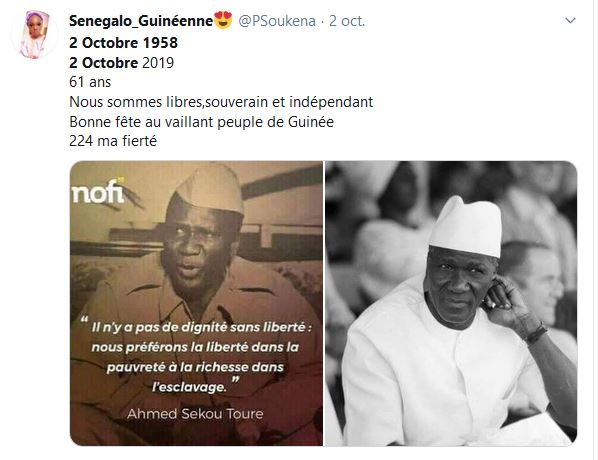Les autorités devraient enquêter sur les abus et strictement contrôler les forces de sécurité.
En Guinée, les forces de sécurité ont réprimé dans la violence des partisans de l’opposition avant et pendant la tenue, le 22 mars 2020, du référendum constitutionnel et des élections législatives, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch.
Les forces de sécurité ont tué au moins huit personnes, dont deux enfants, et blessé une vingtaine d’autres. Depuis la mi-février, les forces de sécurité ont également arrêté des dizaines de partisans présumés de l’opposition et fait disparaître de force au moins 40 autres. Selon des responsables gouvernementaux, neuf membres des forces de sécurité au moins ont été blessés par des manifestants, qui ont également vandalisé des bureaux de vote, brûlé du matériel électoral et menacé les électeurs le jour du scrutin. Le 22 mars, des soldats armés, des gendarmes et des policiers ont été déployés, dans des camionnettes et à pied, dans la capitale guinéenne, Conakry. Ils ont lancé des grenades lacrymogènes et tiré à balles réelles sur des manifestants, faisant au moins six morts, dont une femme, et blessant au moins huit hommes.
« Les forces de sécurité guinéennes ont répondu aux manifestations massives par une violence brutale », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur l’Afrique centrale à Human Rights Watch. « Les manifestations se poursuivront vraisemblablement à l’approche des élections, et donc le gouvernement guinéen devrait immédiatement imposer un strict contrôle aux forces de sécurité nationales. Les dirigeants de l’opposition devraient aussi faire tout leur possible pour aider à mettre fin à la violence. »
L’intention prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat présidentiel lors des élections prévues pour la fin de l’année est à l’origine des manifestations. En décembre 2019, Condé, âgé de 81 ans, a rendu public le texte du nouveau projet de constitution qui, selon ses partisans et ses opposants, ouvrirait la voie à la mise en œuvre d’un troisième mandat. En conséquence, une coalition d’organisations de la société civile, de syndicats et de partis politiques a appelé à des manifestations régulières depuis la mi-2019 et boycotté le référendum. Le 27 mars, la commission électorale guinéenne a annoncé que le nouveau projet de constitution avait été adopté avec plus de 90 % des voix.
Les conclusions de Human Rights Watch s’appuient sur des entretiens téléphoniques menés en mars et début avril avec 60 victimes, membres des familles des victimes et témoins de violations, ainsi qu’avec 15 personnels soignants, journalistes, avocats, membres des partis d’opposition et représentants de la société civile. Human Rights Watch a analysé des photographies et des séquences vidéo pour corroborer les récits des victimes et des témoins. Nous avons également contacté Albert Damatang Camara, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, par téléphone et WhatsApp, et partagé avec lui par e-mail nos conclusions le 23 mars, en lui posant des questions spécifiques, auxquelles Camara n’a pas répondu.
D’après plusieurs témoins, les forces de sécurité étaient parfois accompagnées de civils armés de couteaux et de machettes, qui s’en sont pris aux manifestants, tuant au moins un jeune homme, Diallo Nassouralaye. Certains partisans de l’opposition ont lancé des pierres et autres projectiles sur les forces de sécurité. Des violences ont également éclaté à l’extérieur de la capitale, notamment à Kindia, au nord-est de Conakry, à Kolaboui et Sangaredi, dans l’ouest du pays, et à Nzérékoré, dans le sud-est.
Un témoin a décrit les circonstances au cours desquelles un gendarme a tué à bout portant Issa Yero Diallo, une femme âgée de 28 ans résidant dans le quartier d’Ansoumanyah plateau, à Conakry : « Le gendarme a menacé cette femme avant de lui tirer dessus. Les gens qui se trouvaient là ont essayé de le dissuader, mais il lui a tiré une balle dans le cou. » Selon les habitants, la femme a été prise pour cible après avoir contribué à obtenir la remise en liberté d’un homme arrêté par les gendarmes plus tôt dans la journée. Le ministre Camara a déclaré aux médias le lendemain qu’un gendarme soupçonné du meurtre avait été arrêté.
Le 20 février et le 5 mars à Conakry, les forces de sécurité ont tué deux adolescents et, le 6 mars, arrêté deux membres en vue de l’opposition. Les 11 et 12 février, 40 hommes, dont au moins deux enfants et trois adultes atteint de déficience intellectuelle, ont fait l’objet d’arrestations arbitraires par des membres des forces de sécurité lors de raids menés à Conakry, avant d’être conduits dans une base militaire située à environ 700 kilomètres de Soronkoni, dans l’est de la Guinée. Ils y ont été détenus en l’absence de tout contact avec le monde extérieur, les autorités ayant refusé de reconnaître leur détention jusqu’au 28 mars, date à laquelle 36 d’entre eux ont été remis en liberté et quatre autres transférés à la prison centrale de Conakry où ils sont toujours en détention.
Dans un communiqué de presse en date du 22 mars, le ministre Camara soutient que le référendum « s’est déroulé dans des conditions pacifiques sur l’ensemble du territoire », mais que « certains militants ont tenté de semer la terreur » à Conakry et dans d’autres villes. Dans un entretien accordé aux médias le 31 mars, il a confirmé que six personnes avaient perdu la vie à Conakry le 22 mars, dont une personne ayant succombé à un accident vasculaire cérébral, précisant que les autorités avaient ouvert des enquêtes.
Alors que davantage de manifestations sont prévues dans la perspective des élections plus tard cette année, les autorités guinéennes devraient demander aux forces de sécurité nationales de faire preuve de retenue et de respecter les Lignes directrices pour le maintien de l’ordre par les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique, adoptées par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. En vertu de ces instruments, les responsables de l’application des lois ne peuvent recourir à l’usage de force que lorsque cela est strictement nécessaire et en vue d’atteindre un objectif légitime de maintien de l’ordre.
La CADHP, le Représentant spécial du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union européenne, la France et les États-Unis ont tous condamné ou exprimé leur inquiétude devant les violences suscitées par le référendum. Le 4 mars, le Rapporteur spécial de la CADHP pour la Guinée a appelé le gouvernement à respecter la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à garantir des élections libres, équitables et transparentes. Dans une résolution en date du 11 février, le Parlement européen s’est déclaré préoccupé de la montée des tensions politiques et des violences en Guinée.
Les partenaires internationaux de la Guinée et autres institutions, en particulier l’Union africaine, la CEDEAO, le Conseil de sécurité de l’ONU, l’UE et les États-Unis devraient accroître la pression sur le président Condé et son gouvernement et exiger l’ouverture d’enquêtes et de poursuites judiciaires crédibles pour les violations récentes, a préconisé Human Rights Watch.
En cas d’échec des autorités guinéennes à répondre à ces préoccupations relatives aux droits humains, les États-Unis devraient envisager des sanctions ciblées contre les hauts responsables gouvernementaux responsables de violations, notamment des interdictions de voyager et des gels d’avoirs.
L’UE et ses États membres devraient envisager d’élargir le régime de sanctions en vigueur à l’encontre de la Guinée et rappeler aux autorités du pays les conséquences d’un échec à prendre en compte de façon adéquate les préoccupations relatives aux droits humains.
« Des mesures vigoureuses sont nécessaires dès à présent avant que la situation ne se détériore davantage et qu’une force disproportionnée ne soit utilisée contre les manifestants à l’approche des élections », a conclu Ilaria Allegrozzi. « Les partenaires de la Guinée devraient indiquer clairement que des conséquences seront tirées si des manifestants se font tirer dessus ou des partisans de l’opposition sont portés disparu. »
Contexte
Les débats sur la révision de la constitution guinéenne de 2010 ont commencé début 2019, le parti au pouvoir RPG-Arc-en-ciel ayant appelé en mai les citoyens à soutenir le projet de constitution. Bien que le texte présenté par Condé en décembre 2019 maintienne une limite de deux mandats présidentiels, ses partisans ont déclaré qu’il reprenait tout à zéro, ce qui lui permettrait donc de se présenter en 2020. Condé a déclaré le 10 février que, en cas d’adoption d’une nouvelle constitution, « [son] parti décidera » s’il sera candidat à sa propre succession.
Le 28 février, Condé a reporté le référendum constitutionnel et les élections législatives, initialement prévus le 1er mars, au 22. Les organisations internationales et régionales, dont l’UA, l’Organisation internationale de la Francophonie et la CEDEAO, ont refusé d’envoyer sur place des observateurs, affirmant que la liste électorale manquait de crédibilité.
Depuis octobre 2019, une coalition d’organisations non gouvernementales et de partis d’opposition, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), a organisé de nombreuses manifestations contre le référendum constitutionnel en Guinée.
Bien que le gouvernement ait dans certains cas autorisé la tenue de ces manifestations, la plupart du temps, les forces de sécurité les ont dispersées en arrêtant des participants ou en usant de gaz lacrymogènes et en leur tirant dessus à balles réelles. Human Rights Watch avait précédemment signalé qu’au moins 30 personnes avaient été tuées pendant les manifestations entre octobre 2019 et janvier 2020. Le FNDC estime que les forces de sécurité ont tué 44 personnes depuis octobre 2019. Les manifestants auraient également tué au moins un gendarme lors de manifestations en octobre, selon le gouvernement, bien que les manifestants affirment que celui-ci a été abattu par un autre gendarme.
Violence le jour du référendum à Conakry et dans d’autres villes
Le 22 mars, de violents affrontements ont éclaté à Conakry, notamment dans les quartiers de Wanindara, Hamdallaye, Coza, Sofonia, Ansoumania, Cimenterie et Simbaya, entre des dizaines de groupes favorables au référendum et d’autres qui lui étaient opposés, et entre opposants au référendum et forces de sécurité. Des manifestants ont brûlé des pneus, dressé des barricades dans les rues et lancé des projectiles sur les forces de sécurité qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes et tiré à balles réelles. Le ministre de la Sécurité a déclaré que des manifestants violents avaient saccagé des bureaux de vote, menacé des électeurs et brûlé du matériel électoral, une information confirmée par Human Rights Watch.
Deux témoins ont déclaré à Human Rights Watch que des soldats, des gendarmes, des policiers et des civils armés de machettes avaient lancé des pierres sur une maison du quartier de « Petit Simbaya », où vivaient des partisans de l’opposition connus. Lorsque Diallo Nassouralaye, âgé de 19 ans, qui vivait à proximité, est sorti pour vérifier ce qui se passait, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur lui. « Il a été touché à l’abdomen », a précisé un témoin. « Je l’ai emmené dans un centre de soins tout proche, mais il est décédé sur place. » Le médecin qui s’est occupé de la victime a confirmé à Human Rights Watch que Nassouralaye est arrivé vers 13 heures et est décédé 10 minutes plus tard d’une blessure par balle à l’abdomen.
Selon deux témoins, des gendarmes ont abattu Thierno Oumar Diallo, un homme âgé de 25 ans, lors d’affrontements entre partisans du référendum et des opposants dans le quartier de Kakimbo vers 15 heures. Une source médicale a confirmé que l’homme était décédé des suites d’une blessure par balle au cou. L’un des témoins, frère de la victime, a déclaré :
Des gendarmes sont intervenus lors des affrontements et ont lancé des grenades lacrymogènes et tiré à balles réelles. Des témoins m’ont dit qu’en plus de mon frère, ils avaient tué deux autres hommes et blessé quatre autres. Mon frère est mort instantanément ; d’une balle dans le cou. J’ai emmené son corps dans un centre de soins proche puis à la morgue, mais le personnel médical a refusé de le prendre en charge. J’ai donc ramené sa dépouille à la maison et nous l’avons enterré le lendemain.
Deux témoins ont expliqué que des gendarmes avaient tiré à balles réelles lors d’affrontements entre des partisans du référendum et des membres de l’opposition dans le quartier Hamdallaye de Conakry, tuant Hafiziou Diallo, un homme âgé de 28 ans. Un parent de la victime a été témoin du meurtre :
Nous sommes descendus dans la rue pour protester contre le vote. Il y avait des partisans du référendum en tenue civile, armés de couteaux, et des gendarmes. Nous leur avons jeté des pierres et les choses ont dégénéré. Les gendarmes, une dizaine d’entre eux, ont lancé des grenades lacrymogènes et tiré à balles réelles. Les gens se sont enfuis, mais mon oncle a été touché par une balle et s’est effondré devant moi. Il a été touché à la poitrine.
Human Rights Watch a examiné les photographies du corps et consulté des sources médicales qui ont corroboré ces témoignages.
Un policier a tué Thierno Hamidou Bah, âgé de 25 ans, lors d’une manifestation organisée par l’opposition dans le quartier de Kinifi, selon deux témoins entendus par Human Rights Watch. L’un d’eux a déclaré :
Nous étions dans la rue pour dire non au référendum. Nous étions là pour exprimer notre colère. Nous avons lancé des pierres sur la police. Elle a tiré sur la foule à balles réelles et touché trois personnes, dont mon ami, qui a été atteint à la poitrine et s’est effondré devant moi. Je l’ai transporté dans un centre de soins, où il est décédé.
Un médecin qui a examiné le corps a confirmé que l’homme avait reçu une balle dans la poitrine. Human Rights Watch a également consulté des photographies de la blessure.
Des violences sporadiques se sont poursuivies à Conakry le 23 mars, notamment dans les quartiers de Cosa et Wanindara, où des émeutes ont été signalées, et à Baylobaye, où les forces de sécurité ont tiré sur un homme après être entré par effraction chez lui. « Trois policiers sont entrés chez moi à 15 heures. Je m’y trouvais avec ma femme et mon fils. Ils nous ont accusés de ne pas nous rendre aux urnes. L’un d’eux m’a passé à tabac à l’aide de sa matraque et saisi mon téléphone. Mon fils s’est disputé avec eux et a reçu une balle dans le bras. Je l’ai emmené dans un centre de soins où elle lui a été retirée », a relaté le père de la victime. Human Rights Watch s’est également entretenu avec le médecin qui l’a soignée.
Des violences ont éclaté dans d’autres villes et villages de Guinée le 22 mars. Selon les médias, des manifestants ont saccagé des bureaux de vote à Kindia, au nord-est de Conakry, et à Kolaboui à l’ouest, et harcelé le personnel électoral de Télimélé. Des habitants et des journalistes ont également signalé qu’à Nzérékoré, capitale de la Guinée forestière, des incidents liés aux élections ont déclenché des affrontements intercommunautaires et confessionnels entre des membres armés de la communauté de Guerze, formée majoritairement de chrétiens ou d’animistes, et l’ethnie armée Konianke, principalement musulmane, plusieurs personnes ayant été tuées et des propriétés incendiées.
Des gendarmes ont blessé un homme âgé de 20 ans lors d’une manifestation anti-référendum à Sangaredi, dans l’ouest de la Guinée. Un témoin et un proche de la victime ont indiqué à Human Rights Watch que des gendarmes avaient tiré à balles réelles sur la foule : « Il était 10 heures du matin ; nous étions dehors pour protester contre le vote. Les gendarmes ont tenté de nous disperser. Certains leur ont jeté des pierres. J’ai entendu au moins deux coups de feu. Mon frère a été touché d’une balle à l’épaule et s’est cassé le bras en tombant. »
N’ayant pu être hospitalisée à Sangaredi, la victime a été conduite le lendemain à Conakry. Human Rights Watch a examiné les dossiers médicaux et s’est entretenu avec le médecin qui l’a soignée.
Violences et arrestations préréférendaires
Le 20 mars, la police a tiré à balles réelles lors d’une manifestation organisée par l’opposition dans le quartier Bomboly de Conakry, blessant un homme âgé de 18 ans. La victime s’est entretenue avec Human Rights Watch : « Je me rendais au domicile de mon frère quand je me suis retrouvé au milieu d’une manifestation. Certains participants se sont montrés violents et s’en sont pris à la police en lui jetant des pierres. Celle-ci a riposté en lançant des grenades lacrymogènes puis en tirant à balles réelles. Tout le monde a pris la fuite. J’ai également couru pour me mettre en sécurité. J’ai entendu quatre coups de feu avant de m’effondrer au sol. Une balle m’avait atteint à l’épaule droite. »
Le 6 mars, les forces de sécurité ont procédé à l’arrestation arbitraire de Sekou Koundouno et Ibrahima Diallo, deux membres de premier plan de la direction du FNDC, au domicile de Diallo. Celui-ci a déclaré qu’au moins 20 policiers, dont certains étaient masqués, sont entrés par effraction chez lui à Conakry vers 19 heures, procédant à leur arrestation en l’absence de mandat. La loi guinéenne prévoit pourtant qu’un mandat est nécessaire, à moins que l’individu ne soit pris en flagrant délit. L’épouse de Diallo, qui a été témoin de l’arrestation, a décrit la scène à Human Rights Watch :
J’ai demandé aux policiers s’ils avaient un mandat. Cela les a contrariés. L’un d’eux m’a attrapé par le col de ma chemise et poussé contre un pot de fleurs. Puis ils ont mis la maison sens dessus dessous avant d’arrêter mon mari et Koundouno, qui a été escorté à moitié nu, sans son pantalon ni ses chaussures.
Diallo a déclaré que ses yeux étaient bandés dès qu’il est monté à bord du véhicule de police et que lui et Koundouno ont été détenus à la Direction de la police judiciaire, à Conakry, sans accès à leurs avocats pendant une semaine. Les juges d’instruction ont inculpé les deux membres du FNDC d’ « outrages envers les fonctionnaires » et d’« atteinte et menace à la sûreté et à l’ordre publics », avant de les remettre en liberté sous caution le 13 mars, en l’attente de nouvelles enquêtes. Les deux hommes ont été invités à comparaître devant les juges chaque semaine.
Lors de manifestations à Conakry le 5 mars, deux témoins ont déclaré que les forces de sécurité, dont des policiers et des gendarmes, avaient lancé des gaz lacrymogènes sur des partisans de l’opposition et tué un garçon âgé de 17 ans, heurté à la tête par une grenade. Human Rights Watch a également reçu des informations selon lesquelles les forces de sécurité ont blessé neuf autres hommes lors de ces manifestations. Les gendarmes ont agressé un journaliste français après qu’il les a filmés en train de passer à tabac un homme non armé, avant de l’expulser du pays. Les participants ont déclaré que certains manifestants violents avaient blessé des policiers en leur jetant des pierres.
Le 4 mars, vers 13 heures, une dizaine de policiers et de gendarmes sont entrés par effraction au domicile d’un imam de 51 ans dans le quartier de Wanindara à Conakry, et l’ont roué de coups ainsi que d’autres membres de sa famille. Ils ont ensuite procédé à l’arrestation arbitraire de trois des membres de sa famille et d’un voisin. Selon des témoins et des résidents, les forces de sécurité recherchaient l’auteur d’une vidéo qui montrait la police en train de se servir d’une femme comme bouclier humain à Conakry le 29 janvier. L’imam a déclaré à Human Rights Watch :
Des policiers et des gendarmes sont entrés par effraction dans ma résidence, ont tiré un coup de feu et défoncé la porte d’entrée. Ils ont fouillé les neuf maisons du complexe résidentiel, les ont mises sens dessus dessous. Un gendarme m’a frappé à la tête avec une louche qu’il avait prise à mes femmes. « Je vais te casser la tête », m’a-t-il dit. Les gendarmes ont également frappé deux de mes voisins, dont une femme de 80 ans souffrant de problèmes de surdité et de vue. Puis ils ont arrêté mes fils, mon frère et un voisin. Ils n’avaient aucun mandat. »
Les quatre hommes arrêtés ont été conduits dans deux postes de gendarmerie des quartiers de Matoto et Cosa. Les fils et le frère de l’imam ont été remis en liberté le même jour après le paiement d’un million de francs guinéens (environ 104 dollars). Son voisin a été relâché le lendemain après le versement de 250 000 francs guinéens (environ 26 dollars).
Le 19 février, des gendarmes et des policiers ont violemment réprimé une manifestation menée par le FNDC dans le quartier de Wanindara en lançant des grenades lacrymogènes et en tirant à balles réelles. Ils ont blessé au moins un manifestant, un chauffeur âgé de 26 ans, alors qu’il tentait de prendre la fuite : « Certains gendarmes sont descendus de leur véhicule et ont pourchassé des manifestants à pied. J’ai couru et tenté de me cacher, mais un gendarme m’a tiré dans la cuisse. J’ai été conduit à l’hôpital, où je suis resté alité 10 jours. La balle se trouve toujours dans ma jambe. » Cet homme a également confié qu’il était à peine en état de marcher et ne pouvait plus travailler. Human Rights Watch a également interrogé un de ses amis qui a été témoin de l’incident, ainsi que le médecin qui l’a soigné.
Disparitions forcées
Human Rights Watch s’est entretenu avec 10 hommes victimes de disparitions forcées pendant une quarantaine de jours à la suite de leur arrestation arbitraire par les forces de sécurité à Conakry les 11 et 12 février. Ils ont déclaré avoir été détenus sans aucun contact avec le monde extérieur avec 30 autres personnes, dont au moins deux enfants et trois hommes atteints de déficience intellectuelle, dans une base militaire de Soronkoni, à 700 kilomètres de Conakry. Human Rights Watch a également parlé à leurs avocats et à plusieurs membres de leurs familles et amis qui ont corroboré leurs témoignages. Pendant leur détention, les autorités ont refusé de reconnaître qu’elles savaient où se trouvaient ces hommes.
En vertu du droit international, une disparition forcée est toute forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve. La Guinée n’a pas signataire de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
D’anciens détenus et avocats ont déclaré que, à l’exception de quatre personnes transférées à la prison centrale de Conakry, les 36 autres avaient été remises en liberté le 28 mars, sans inculpation ni document attestant de leur arrestation et de leur détention.
Les dix hommes avec qui s’est entretenu Human Rights Watch ont déclaré qu’on ne leur avait jamais fourni d’explication quant aux raisons de leur arrestation et de leur détention. Mais ils ont affirmé que les forces de sécurité qui les avaient arrêtés, comme les militaires qui assuraient leur détention à Soronkoni, les avaient accusés de soutenir l’opposition. Selon l’un de ces ex-détenus, âgé de 20 ans, un policier lui a dit au moment de son arrestation : « C’est vous qui barricadez les routes, semez le trouble et vous opposez au pouvoir en place. » « Ils m’ont accusé d’être un criminel et de faire souffrir mon pays. Je leur ai répondu que je n’étais qu’un chauffeur de taxi. Tiens-toi tranquille et tais-toi, m’ont-ils rétorqué », a témoigné un autre ex-détenu, âgé de 36 ans.
En vertu du droit guinéen et du droit international, les individus arrêtés doivent être directement incarcérés dans des lieux de détention reconnus, comme des postes de police ou de gendarmerie, et avoir immédiatement accès à leur avocat et à leurs familles. Toutes les personnes détenues devraient être conduites rapidement devant un juge pour l’examen de la légalité et la nécessité de leur détention.
Cependant, les hommes interrogés par Human Rights Watch ont déclaré avoir été détenus dans une base militaire et privés de contact avec le monde extérieur. « Détenir quelqu’un dans un camp militaire est contraire à notre législation », a indiqué à Human Rights Watch un avocat guinéen défendant les détenus. « Les autorités devraient cesser de penser que la Guinée est une autre planète. Nous avons des lois interdisant la détention de suspects en dehors des lieux officiellement prévus à cet effet ». Âgé de 26 ans, un ex-détenu a déclaré : « Ma famille ignorait où je me trouvais. Ils pensaient que j’étais mort. »
D’autres ont décrit les conditions de leur détention comme sordides. « Nous étions 40 dans une cellule comportant une seule porte, fermée la plupart du temps, avec deux petits trous dans le mur », a déclaré l’un d’entre eux, âgé de 23 ans. « C’était insuffisamment aéré, il faisait très chaud. Beaucoup se sont sentis mal à cause de la chaleur, certains se sont effondrés ». Un autre a expliqué qu’on ne leur donnait pas assez d’eau, et qu’il dormait sur le sol sans matelas et n’était souvent pas autorisé à se rendre aux toilettes situées à l’extérieur, ce qui l’obligeait à uriner dans des bouteilles.
hrw.org